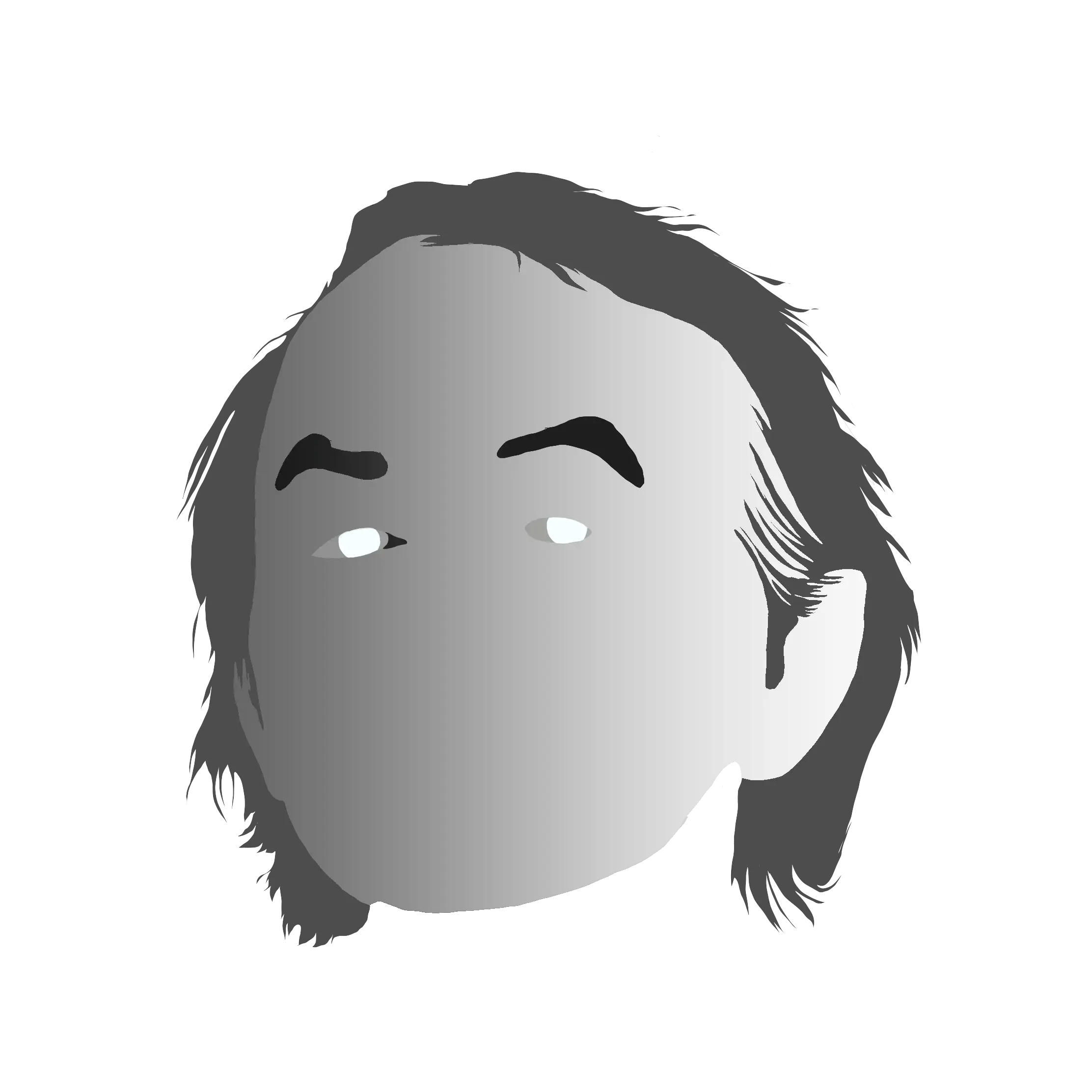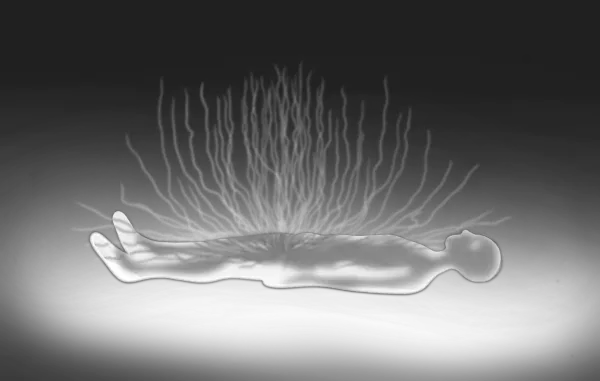L’écrivain Michel Houellebecq est à la recherche d’une nouvelle ontologie
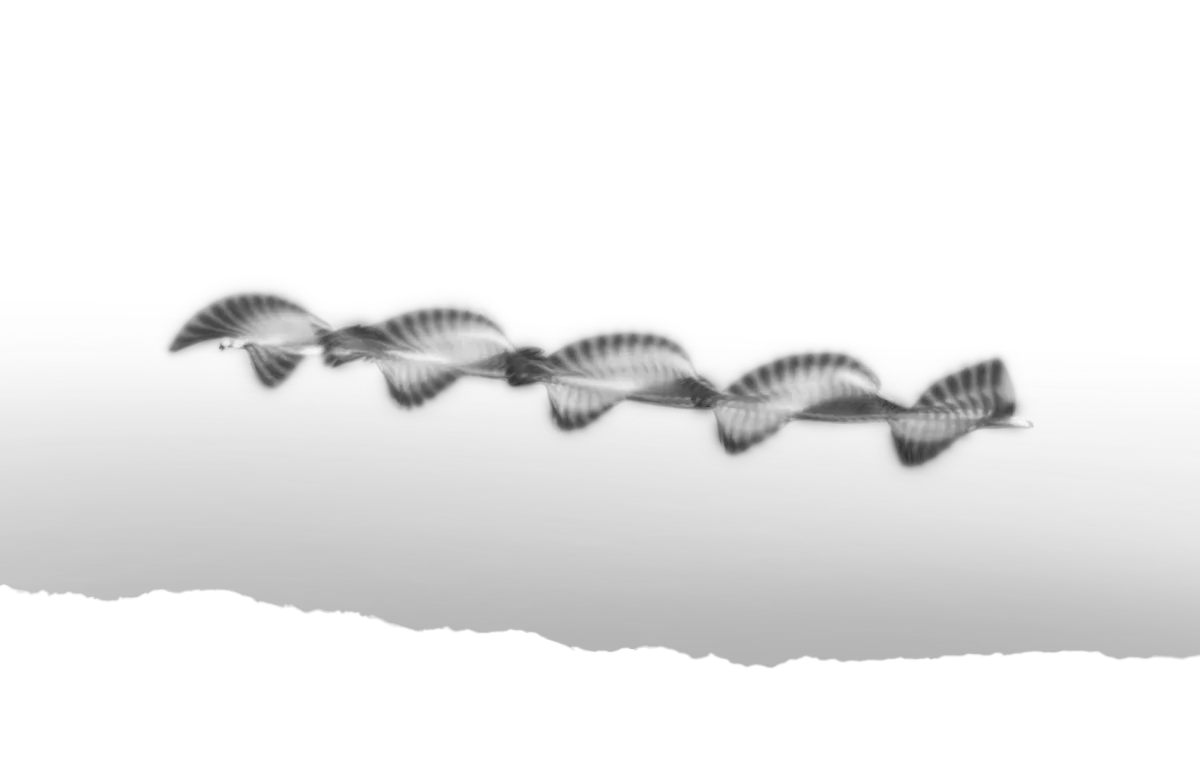
Défiant les circuits littéraires rythmés par les rentrées d’automne et de printemps, parties visibles de l’iceberg de la promotion littéraire, les textes de Michel Houellebecq (trente-huit ans) déposent dans la conscience de ses lecteurs quelque chose qui subsiste. Certains n’hésitent pas à évoquer un phénomène Houellebecq. Il est vrai que dès la publication de son premier ouvrage, Rester vivant, un mouvement était perceptible ; mouvement qui s’est concrétisé à l’occasion de la parution d’Extension du domaine de la lutte, en 1994. Avec Le Sens du combat, recueil de poèmes qui vient de paraître, Michel Houellebecq prolonge un succès lent, long et sûr. Il répond ici à nos questions.
Les titres de vos ouvrages sonnent comme autant d’appels ou d’incitations à la résistance, à un monde dont vous montrez — à travers le quotidien le plus apparemment insignifiant, et particulièrement dans l’entreprise — qu’il s’érige sur une mystification de plus en plus flagrante…
Mes personnages ne sont ni riches ni célèbres ; ce ne sont pas non plus des marginaux, des délinquants ni des exclus. On peut trouver des secrétaires, des techniciens, des employés de bureau, des cadres. Des gens qui perdent parfois leur emploi, qui sont parfois victimes d’une dépression. Donc des gens tout à fait moyens, a priori peu attirants d’un point de vue romanesque. C’est sans doute cette présence d’un univers banal, rarement décrit (d’autant plus rarement que les écrivains le connaissent mal), qui a surpris dans mes livres, en particulier dans mon roman. Peut-être aussi suis-je parvenu, en effet, à décrire certains mensonges usuels, pathétiques, que les gens se font à eux-mêmes pour supporter le malheur de leurs vies.
Décrivant un monde que le libéralisme vide de son humanité, vous estimez que « cet effacement progressif des relations humaines n’est pas sans poser certains problèmes au roman…Nous sommes loin des “Hauts de Hurlevent”, c’est le moins qu’on puisse dire. La forme romanesque n’est pas conçue pour peindre l’indifférence ni le néant ; il faudrait inventer une articulation plus plate, plus concise et plus morne ». La question ne se pose-t-elle pas pour la poésie ?
Nous vivons toujours des moments étranges, d’une très grande densité, pour lesquels la poésie est un moyen de traduction naturel et immédiat. Ce qui est typiquement moderne, c’est que ces moments ont beaucoup de mal à s’insérer dans une continuité sensée. Voilà une chose que beaucoup de gens ressentent : par brefs instants, ils vivent ; pourtant leur vie prise dans son ensemble n’a ni direction ni sens. C’est pour cela qu’il est devenu difficile d’écrire un roman honnête, dénué de clichés, dans lequel, pourtant, il puisse y avoir une progression romanesque. Je ne suis pas très certain d’avoir trouvé une solution ; j’ai l’impression qu’on peut procéder par injection brutale dans la matière romanesque de théorie et d’histoire.
Les bouleversements des relations et du statut des hommes et des femmes se répercutent dans vos textes. De manière douloureuse, souvent… Que pensez-vous de ce que disait Aragon : « La femme est l’avenir de l’homme. » ?
Ce qu’on a appelé la « libération de la femme » arrangeait plutôt les hommes, qui y voyaient l’occasion d’une multiplication des rencontres sexuelles. Il s’en est ensuivi une dissolution du couple et de la famille, c’est-à-dire des dernières communautés qui séparaient l’individu du marché. Je crois que c’est très généralement une catastrophe humaine ; mais que, là encore, ce sont les femmes qui en souffrent le plus. En situation traditionnelle, l’homme évoluait dans un monde plus libre et plus ouvert que celui de la femme ; c’est-à-dire également dans un monde plus dur, plus compétitif, plus égoïste et plus violent. Classiquement, les valeurs féminines étaient empreintes d’altruisme, d’amour, de compassion, de fidélité et de douceur. Même si ces valeurs ont été tournées en dérision, il faut le dire nettement : ce sont des valeurs de civilisation supérieures, dont la disparition totale serait une tragédie. Dans ce contexte, le vers d’Aragon que vous citez me paraît relever d’un optimisme invraisemblable ; mais les vieux poètes ont le droit de devenir visionnaires, de se projeter dans un avenir dont les premiers linéaments sont encore inaperçus. Dans l’histoire de l’humanité, il est en effet possible que la masculinité soit une parenthèse — une parenthèse malheureuse.
On reproche aux partis politiques, le PCF compris, bien qu’il soit engagé dans une mutation, de véhiculer un conformisme à la longue mortifère, d’agir selon des pratiques qui ne correspondent plus aux besoins vitaux de la société et de fonctionner beaucoup trop en circuit fermé. Qu’en pensez-vous ?
Depuis septembre 1992, où nous avons commis l’erreur de voter oui à Maastricht, un sentiment nouveau s’est répandu dans le pays : le sentiment que les hommes politiques ne peuvent rien faire, n’ont aucun contrôle réel sur les événements, et en auront de moins en moins. Par le biais d’une fatalité économique inexorable, la France bascule lentement dans le camp des pays moyens-pauvres. Ce que le public éprouve pour les hommes politiques, dans ces conditions, c’est évidemment du mépris. Les hommes politiques le sentent, et se méprisent eux-mêmes. On assiste à un jeu truqué, malsain, funeste. De tout cela, il est difficile de prendre une conscience exacte. Si l’art parvenait à donner une image à peu près honnête du chaos actuel, je crois que ce serait déjà énorme ; et qu’on ne pourrait vraiment rien lui demander de plus. Si l’on se sent capable d’exprimer une pensée cohérente, c’est bien ; si l’on a des doutes, il faut également en faire part. À titre personnel, il me semble que la seule voie est de continuer à exprimer, sans compromis, les contradictions qui me déchirent ; tout en sachant que ces contradictions s’avéreront, très vraisemblablement, représentatives de mon époque.
À plusieurs reprises, vous évoquez dans vos textes la figure de Robespierre, et dans un entretien vous vous dites partisan d’une société communiste, tout en reconnaissant que ça ne marcherait pas très bien avec des individus comme vous. Par ailleurs, dans votre poème « Dernier rempart contre le libéralisme », vous vous référez à l’encyclique de Léon XIII sur la mission sociale de l’Évangile. Et dans le même temps, vous confiez, ce qui pour moi n’est pas antagonique : « J’ai plus que des doutes… » Nous savons bien que ceux qui annoncent la fin de l’Histoire nous racontent des histoires. Politiquement, ici et maintenant et en perspective, comment faire, selon vous, pour que l’homme reste dans l’homme ?
L’anecdote est peut-être apocryphe, mais je l’aime beaucoup : ce serait Robespierre qui aurait insisté pour ajouter le mot « Fraternité » à la devise de la République. Comme s’il avait senti, dans une intuition fulgurante, que la liberté et l’égalité étaient deux termes antinomiques ; qu’un troisième terme était absolument nécessaire. Même intuition dans les derniers temps lorsqu’il tente d’engager le combat contre l’athéisme, de promouvoir le culte de l’Être Suprême (ceci en plein milieu des périls, de la disette, de la guerre extérieure et civile) ; on peut y voir une préfiguration du concept comtien de Grand-Être. Plus généralement, je crois peu vraisemblable qu’une civilisation puisse subsister longtemps sans religion quelconque (en précisant bien qu’une religion peut être athée, comme l’est par exemple le bouddhisme). La conciliation raisonnée des égoïsmes, erreur du siècle des Lumières à laquelle les libéraux actuels continuent à se référer dans leur incurable niaiserie (à moins que ce ne soit un cynisme, ce qui reviendrait d’ailleurs au même), me paraît une base d’une dérisoire fragilité. Dans l’entretien dont vous parlez, je me décrivais comme « communiste, mais non marxiste » ; l’erreur du marxisme a été de s’imaginer qu’il suffisait de changer les structures économiques, que le reste suivrait. Le reste, on l’a vu, n’a pas suivi. Si, par exemple, les jeunes Russes se sont si rapidement adaptés à l’ambiance répugnante d’un capitalisme mafieux, c’est que le régime précédent s’était montré incapable de promouvoir l’altruisme. S’il n’y est pas parvenu, c’est que le matérialisme dialectique, basé sur les mêmes prémisses philosophiques erronées que le libéralisme, est par construction incapable d’aboutir à une morale altruiste. Ceci dit, quoique douloureusement conscient de la nécessité d’une dimension religieuse, je suis à titre personnel foncièrement antireligieux. Le problème est qu’aucune religion actuelle n’est compatible avec l’état général des connaissances ; ce qu’il nous faudrait, c’est carrément une nouvelle ontologie. Ces problèmes peuvent paraître exagérément intellectuels ; je crois cependant qu’ils ont, de proche en proche, d’énormes conséquences concrètes. Si rien ne se produit de ce côté, à mon avis la civilisation occidentale n’a aucune chance.