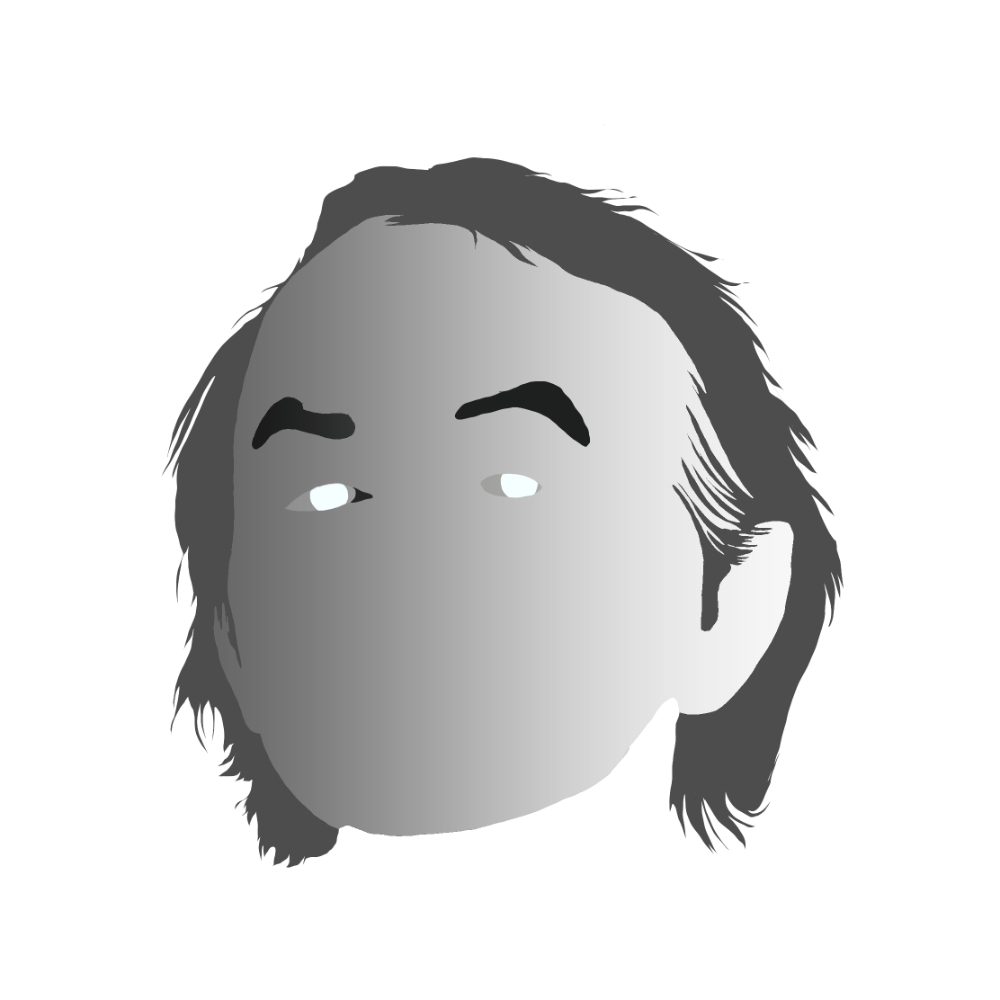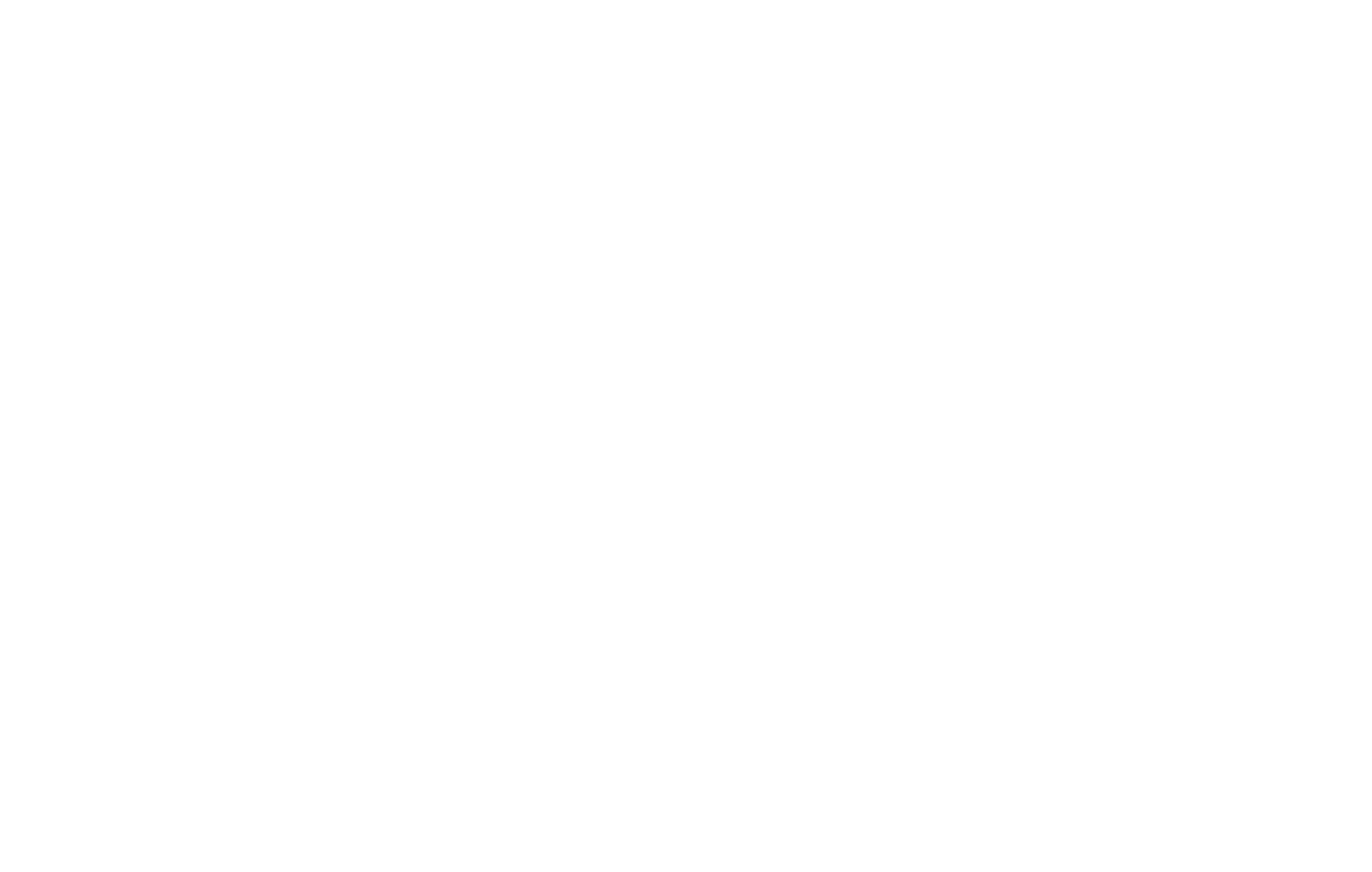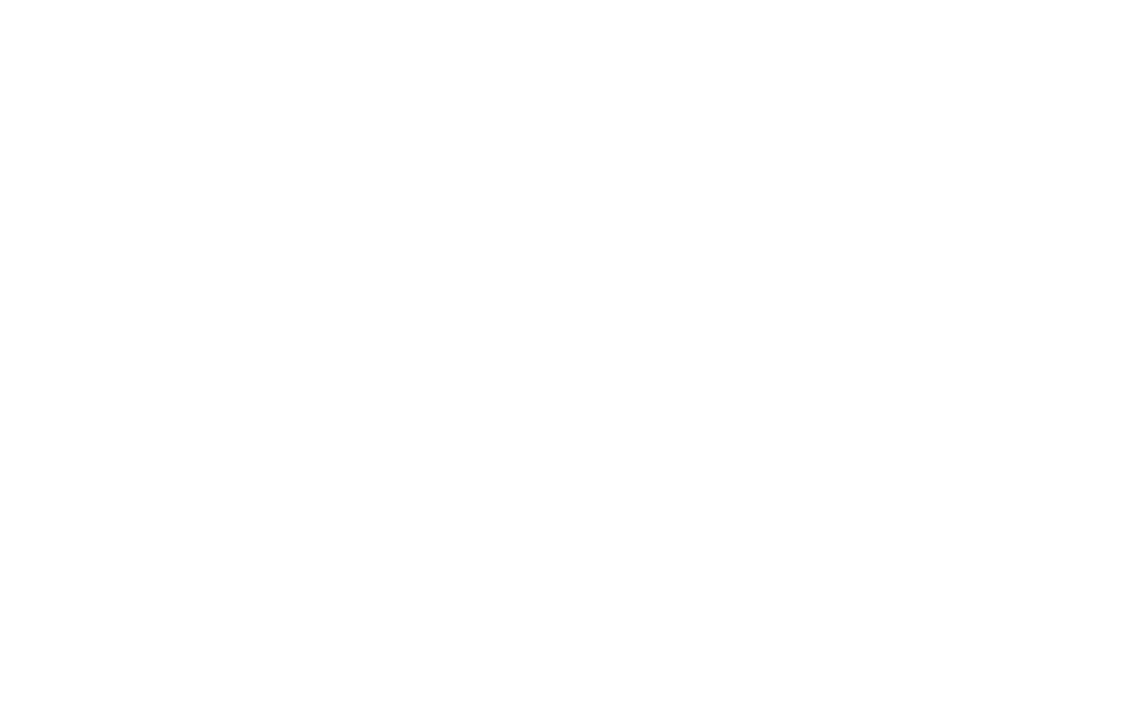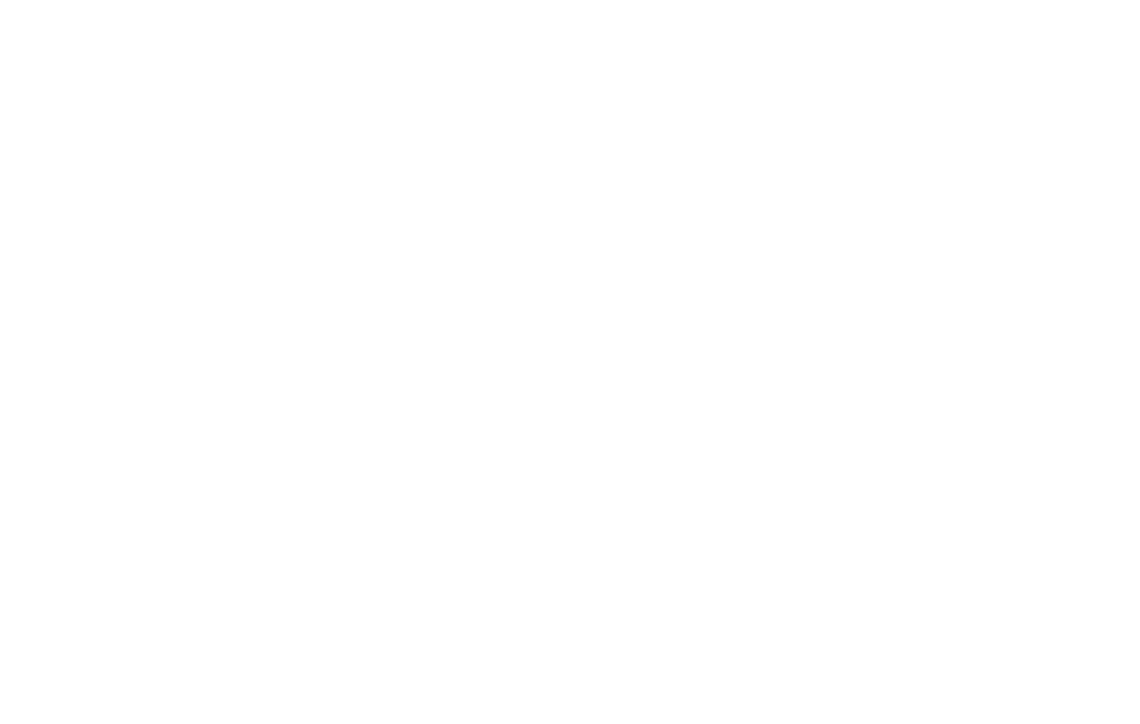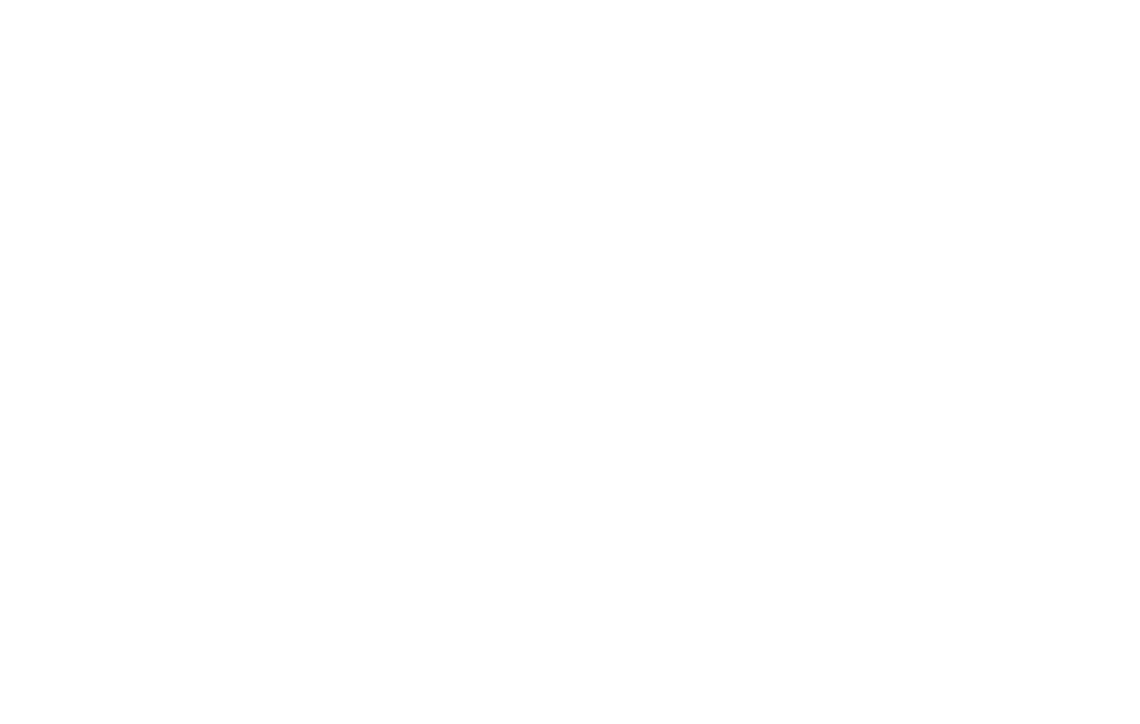À propos d’euthanasie et de suicide assisté.
Commençons par un petit paragraphe malicieux. Guy Debord a choisi de se suicider à l’ancienne ; Jean-Luc Godard, « le plus bête des maoïstes suisses », selon l’amusant slogan d’inspiration situationniste, a opté pour le suicide assisté ; le prochain provocateur de génie optera sans doute pour l’euthanasie médicalisée. La barre, comme on dit, ne cesse de s’abaisser.
En revanche, Mark Zuckerberg a remonté dans mon estime (ce qui n’est pas difficile) lorsque j’ai appris qu’il avait décidé de ne plus manger d’animaux, sauf ceux qu’il tuait lui-même. C’est un engagement que l’on pourrait suggérer (ou exiger ?) à tous ceux qui se moquent du végétarisme. Il en va de même pour les partisans de la peine de mort. Ne serait-il pas intéressant d’engager un peloton d’exécution composé du jury qui a voté pour la peine capitale ? (Je suis désolé de sauter des animaux aux personnes, mais c’est fondamentalement la même question). Je ne suis pas un végétarien convaincu, ni résolument contre la peine de mort, mais je crois que nous devons accepter les conséquences de nos choix.
La plupart des gens mangent tous les jours (c’est certainement le cas de Zuckerberg), mais il y a de fortes chances pour que vous ne croisiez jamais le chemin d’un meurtrier ou que vous ne fassiez pas partie du jury d’un procès criminel. Il existe cependant des circonstances — rares mais pas exceptionnelles — dans lesquelles on peut se trouver, au cours d’une vie assez longue, confronté à une décision de ce poids. Pour nous préparer à cette éventualité, tentons une expérience de pensée (Gedankenexperiment).
Supposons — l’idée n’est pas si absurde — que je sois capable, grâce à des relations ou à mon habileté à naviguer sur le dark web, de mettre la main sur du pentobarbital, un poison mortel apparemment indolore. Supposons ensuite qu’un ami à qui la vie est devenue insupportable me demande de lui en donner. Comment dois-je réagir ? Il ne fait aucun doute que faire ce qu’il demande renforcerait sa liberté individuelle. Cette justification est-elle suffisante ? Dans les dix États américains (plus le district de Columbia) où le suicide assisté est légal, la proportion de malades qui finissent par ne pas prendre le cocktail qui leur a été donné est loin d’être négligeable : elle approche potentiellement la moitié dans certaines juridictions. Comme l’écrit Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal, « La pensée du suicide est une grande consolation : grâce à elle, on réussit à passer bien de mauvaises nuits ». En effet, c’est souvent la seule consolation. Et pourtant, je crois que l’achat de poison pour les personnes ayant des antécédents de sautes d’humeur, comme moi, devrait être découragé. La majorité des gens qui en achètent finissent par se tuer. Comment me sentirais-je si mon ami décidait, quelques mois plus tard, de prendre la dose que je lui avais donnée ? Comment vous sentiriez-vous ?
Et comment réagiriez-vous si un étranger vous demandait la même chose en échange d’argent ? Et si c’était beaucoup d’argent ? Si, après avoir gracieusement franchi cet obstacle éthique, vous envisagez de vous lancer dans le suicide assisté, je ne vous recommande pas la Suisse. Outre l’organisation à but non lucratif Dignitas, que j’ai grossièrement insultée dans l’un de mes romans — le procès qui en a résulté a reçu moins d’attention que celui concernant l’islam, mais j’en suis tout de même assez fier, puisqu’ils ont perdu (ils ont exigé que leur nom soit retiré des éditions allemande et suisse) —, il y a l’organisation Dignitas, qui a fait l’objet d’un procès.
Il y a aussi le cercle de vie et le leader du secteur EXIT, choisi par Godard. En d’autres termes, il s’agit d’un marché assez encombré.
Supposons, pour poursuivre l’expérience, que vous viviez dans une démocratie et que la question soit soumise à un référendum. Comment voteriez-vous ?
« Je n’administrerai pas non plus de poison à qui que ce soit si on me le demande, et je ne le suggérerai pas non plus. De même, je ne donnerai pas à une femme un pessaire pour provoquer un avortement. Mais je garderai purs et saints ma vie et mon art. » On ressent une certaine nostalgie face à la noble sérénité du serment d’Hippocrate — ou, pour utiliser un terme actuel, sa décence fondamentale — qui perdure jusqu’à sa dernière phrase. « Maintenant, si j’exécute ce serment et ne le brise pas, que je gagne à jamais la réputation de tous les hommes pour ma vie et pour mon art ; mais si je le transgresse et me renie, que le contraire m’arrive. »
Hippocrate a vécu bien avant l’avènement du christianisme — un fait significatif. Tous les opposants à l’euthanasie que je connais sont de fervents chrétiens ; en tant que seul agnostique parmi eux, je me sens parfois incompris. Non pas qu’ils doutent de mes convictions, que je n’ai que trop souvent exprimées, mais parce que mes motivations leur échappent, du moins je le sens. (Pour compliquer les choses, je soutiens le droit à l’avortement, du moins sous certaines conditions, mais c’est un autre sujet).
Pour Emmanuel Kant, la dignité humaine interdisait clairement le suicide. Mais il a fallu à Kant un énorme effort intellectuel pour dégager la dignité humaine et la loi morale de la métaphysique (autrement dit, du christianisme). Qui peut prendre la mesure de cet effort aujourd’hui ? La dignité est devenue un mot vide de sens, une plaisanterie de mauvais goût. J’ai même l’impression que pour mes contemporains, l’idée d’une loi morale est devenue assez obscure.
Peu à peu, et sans que personne ne s’y oppose — ni même ne semble s’en apercevoir — notre droit civil s’est éloigné de la loi morale dont l’accomplissement devrait être son seul but. Il est difficile et épuisant de vivre dans un pays où les lois sont méprisées, qu’elles sanctionnent des actes qui n’ont rien à voir avec la morale ou qu’elles tolèrent des actes moralement abjects. Mais c’est encore pire de vivre parmi des gens que l’on commence à mépriser pour leur soumission à ces lois qu’ils méprisent comme pour leur avidité à en exiger de nouvelles. Un suicide assisté, dans lequel un médecin prescrit un cocktail létal que le patient s’administre lui-même dans les circonstances de son choix, reste un suicide. Dans le cas improbable où quelqu’un serait en mesure de me fournir une bouteille de pentobarbital et un verre pour l’accompagner, la première chose que je lui demanderais serait de quitter la pièce. Lorsque j’apprends que quelqu’un que je connais s’est suicidé, ce que je ressens n’est pas du respect — je ne veux pas exagérer — mais pas non plus de la désapprobation, ni de la dérision.
L’assistance au suicide par une méthode ou une autre a été légalisée dans une grande partie des États-Unis et en Suisse. En France, nous sommes sur le point d’approuver l’euthanasie administrée par un médecin, après la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Espagne. En d’autres termes, elle est en train de devenir la façon européenne de mourir. Nous démontrons une fois de plus notre faible respect pour la liberté individuelle et notre appétit malsain pour le micromanagement — un état de fait que nous appelons trompeusement « bien-être » mais qui est plus précisément décrit comme de la servitude. Ce mélange d’infantilisation extrême, par lequel on accorde à un médecin le droit de mettre fin à sa vie, et de désir pétulant de « liberté ultime » est une combinaison qui, très franchement, me dégoûte.
Les groupes qui prônent la légalisation de l’euthanasie volontaire soutiennent que cette procédure est la seule alternative humaine lorsque les derniers jours, semaines ou mois de la vie d’une personne seront autrement remplis de douleurs insupportables. Cet argument repose sur deux mensonges, d’autant plus efficaces qu’ils sont à la fois terrifiants et rarement formulés. Le premier a trait à la souffrance — la souffrance physique. J’ai peut-être de la chance, mais dans tous les cas d’agonie physique que j’ai connus, la morphine a suffi à me soulager. Ce médicament miracle a été découvert au début du XIXe siècle et, depuis, de nombreux progrès ont été réalisés ; des dérivés opioïdes bien plus puissants que la molécule originale de morphine ont été synthétisés. À notre époque — il faut le dire clairement et le répéter sans cesse — la douleur physique peut être vaincue.
Le deuxième mensonge est plus insidieux. Ce n’est qu’à la télévision (Américaine en particulier) que l’on demande à un médecin : « Combien de temps me reste-t-il, docteur ? » et qu’il répond avec la gravité qui convient : « Trois semaines au maximum ». Dans la vie réelle, les médecins sont plus circonspects. Ils savent, parce que leur formation de base est scientifique, que le temps qu’il nous reste se conforme, comme beaucoup de choses dans ce monde, à une courbe en cloche.
Dans presque tous les pays, toutes les époques, toutes les religions, toutes les civilisations et toutes les cultures, l’agonie a été considérée comme un aspect crucial de notre existence. Les études sur la mort ne manquent pas : pour l’Occident chrétien, je recommande les travaux de Philippe Ariès. Que vous croyiez ou non à l’existence d’un créateur qui vous demandera des comptes, c’est le moment de l’adieu, la dernière chance de voir certaines personnes, de leur dire ce que vous n’avez peut-être jamais dit et d’entendre ce qu’elles ont à vous dire. Couper court à ces affres de la mort est à la fois impie (pour ceux qui croient) et immoral (pour quiconque). C’est le consensus des civilisations, des religions et des cultures qui nous ont précédés, et c’est ce que le soi-disant progressisme s’apprête à détruire.
Ce moment d’adieu peut se produire lors d’un suicide assisté — auquel cas nous aurions quelque chose comme la scène de Socrate et de la ciguë. Mais il ne peut pas se produire si ce moment arrive en fonction des directives anticipées. Ce n’est pas le travail des médecins de mettre fin aux vies. En fait, c’est exactement le contraire de leur travail. Et en France, de nombreux médecins sont fortement opposés à la légalisation de l’euthanasie. Ce n’est pas une responsabilité qu’ils ont envie d’assumer.
La science-fiction américaine des années 50 et 60 a exploré avec une puissance impressionnante et visionnaire un ensemble de sujets qui font aujourd’hui partie, ou ont commencé à faire partie, de notre quotidien : Internet, le transhumanisme, la quête de l’immortalité et la création de robots intelligents. Pour ces auteurs, l’idée de l’euthanasie, conçue comme une solution aux problèmes économiques posés par le vieillissement de la population, était un sujet évident — presque trop évident. L’œuvre la plus connue de ce genre est sans aucun doute Make Room! Make Room! en grande partie grâce à la version cinématographique Soylent Green, avec une performance extraordinaire d’Edward G. Robinson. Mais mon œuvre préférée est « The Test », une nouvelle émouvante de Richard Matheson, curieusement jamais adaptée au cinéma, pour autant que je sache, bien que le cinéma ait été favorable à Matheson et que l’histoire serait facile à adapter. Dans le monde de l’histoire, les personnes âgées sont soumises régulièrement à des tests de compétence qu’elles doivent réussir pour éviter d’être mises hors d’état de nuire. Pendant ce temps, leurs descendants restent assis à la maison, espérant tranquillement le résultat qui les libérera du fardeau du vieillissement. Une fois qu’on a lu « The test », il me semble qu’il n’y a plus rien à dire contre l’euthanasie ; l’histoire dit tout.