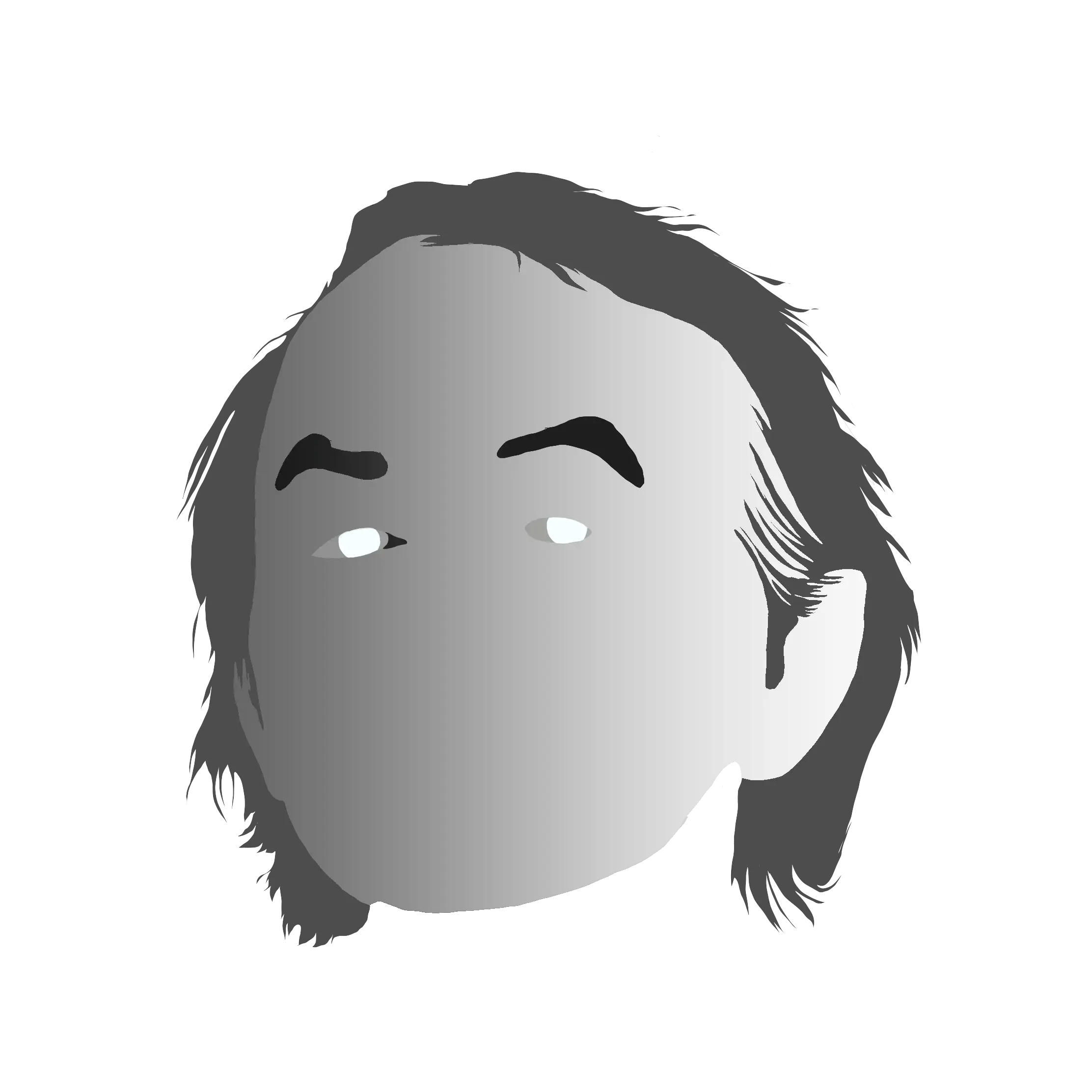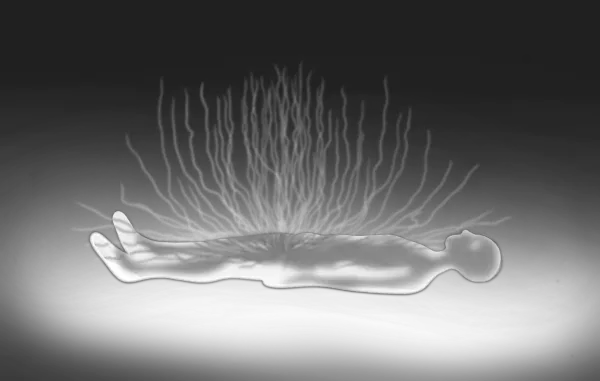Emmanuel Carrère et le problème du bien
Peut-être aussi que la question de la communauté humaine en général m’intéresse moins parce que je m’intéresse passionnément à cette communauté plus restreinte composée par un homme et une femme. Emmanuel Carrère s’y intéresse beaucoup lui aussi, l’amour tient une place considérable dans nos livres, a tous les deux (il insiste de manière très émouvante sur l’amour conjugal, sur la sexualité conjugale aussi). Mais la question de la communauté humaine en général, il n’y a pas renoncé.
Parmi les nombreux passages bouleversants qui jalonnent D’autres vies que la mienne, un des plus déchirants pour moi est celui de la vieille lesbienne anglaise, qui vient de perdre sa compagne dans la catastrophe. « Elle disait : my girlfriend, et j’imagine ce couple de lesbiennes vieillissantes, habitant une petite ville anglaise, engagées dans la vie associative, leur maison arrangée avec amour, leurs voyages chaque année dans des pays lointains, leurs albums de photos, tout cela brisé. Le retour de la survivante, la maison vide. Les mugs au nom de chacune, et l’un des deux ne servira jamais plus, et la grosse femme assise à la table de la cuisine prend sa tête dans ses mains et pleure et se dit qu’à présent elle est seule et qu’elle restera seule jusqu’à sa mort. »
Emmanuel Carrère a bel et bien rencontré cette lesbienne anglaise vieillissante, lors de ces vacances à Ceylan qui se sont si mal terminées ; mais il a imaginé les mugs. Ce qui situe assez bien, il me semble, la marge d’invention qu’il s’autorise, dans ce livre où « tout est vrai ». Elle n’est pas insignifiante. Parce que ce n’est pas rien, ces mugs. C’est exactement au moment des mugs, je m’en souviens, que j’ai éclaté en sanglots, et que j’ai dû reposer le livre, incapable pendant quelques minutes de poursuivre ma lecture. Il est de toute façon impossible de retracer des faits. Même lorsqu’on le fait en dehors de toute ambition littéraire, on est toujours obligé d’inventer, plus ou moins. Il reste que dans tous les livres qu’il écrit actuellement, Emmanuel Carrère a choisi de n’inventer ni les personnages, ni les événements majeurs ; il a choisi pour l’essentiel de se comporter en témoin (pas en témoin exact, c’est impossible je viens de le dire ; mais en témoin). Ce choix m’intéresse évidemment, ne serait-ce que parce que je men suis tenu, jusqu’à présent, à la voie inverse. Pour des raisons esthétiques si on veut, mais aussi pour des raisons douteuses où se mêlent paresse, insolence et mégalomanie (genre : m’emmerdez pas avec les détails, j’ai pas de temps à perdre avec la réalité, et de toute façon la réalité je la connais mieux que personne).
Mais enfin passons, revenons à Emmanuel Carrère. Je ne sais pas exactement quand, dans quelles circonstances il s’est résolu à ce choix ; mais il me semble avoir une petite idée du pourquoi. Elle me vient, bizarrement, de mes premiers travaux sur Lovecraft. Avec la sympathique radicalité qui le caractérise, l’auteur américain prend congé du roman réaliste par ces mots : « Le chaos de l’univers est si total qu’aucun texte écrit ne peut en donner même un aperçu. » Il me semble qu’Emmanuel Carrère, à un moment donné, s’est trouvé confronté à un problème du même ordre. Les gens, c’est le moins qu’on puisse dire, ne savent plus comment vivre. Le chaos est si total, le désarroi si généralisé qu’aucun modèle de comportement hérité des siècles anciens ne paraît applicable aux temps que nous vivons. À un moment donné, il est apparu à Emmanuel Carrère impossible non seulement d’utiliser les types existants, mais même d’en créer de nouveaux. Le temps de « l’homme sans type », prophétisé quoique de manière approximative par Musil, était advenu. Circonstance aggravante, Emmanuel Carrère était proche d’une pittoresque mouvance, lointaine résurgence des tenants de l’art pour l’art, qui croyait esquiver le problème en résumant l’intérêt de la littérature à la virtuosité langagière qui s’y déploie. En somme, il s’est un peu trouvé dans la même situation que ces militants maoïstes ayant accompli leur autocritique, se sentant menacés par un déviationnisme formaliste, qui décidaient de retourner travailler en usine, au contact du prolétariat réel.
(J’aimerais que cette comparaison un peu irrévérencieuse ne soit pas prise en mauvaise part ; car après tout ces militants maoïstes, lorsqu’ils décidaient de retourner en usine, avaient tout simplement raison ; la preuve en était régulièrement administrée par le fait qu’une fois établis, ils ne tardaient pas à renoncer au maoïsme, et au militantisme aussi bien ; la théorie n’avait pas résisté à l’épreuve du réel.)
Abordant le monde sans théorie préconçue, Emmanuel Carrère n’est pourtant nullement dépourvu de structuration intellectuelle ; car ce qu’il possède au plus haut point, et qui est largement aussi structurant qu’une théorie, ce sont des valeurs. Et là il est nécessaire de remonter un peu haut, tant sur ce point il tranche non seulement avec ses contemporains, mais même avec les deux ou trois générations qui l’ont précédé.
Pour les auteurs du XIXe siècle, la question du bien et du mal ne se pose nullement. Ni Balzac, ni Dickens, ni Dostoïevski, ni Maupassant, ni Flaubert n’ont le moindre doute sur les moments où le comportement de leurs personnages leur paraît estimable, admirable, légèrement condamnable ou franchement abject. Qu’ils choisissent ensuite de déployer un spectre moral très large, de mettre en scène des cas extrêmes, ou au contraire de concentrer leur attention sur des caractères moyens, est un choix esthétique personnel, où les variations sont infinies. Mais les bases du jugement moral sont chez eux aussi solides et indiscutables qu’elles l’ont toujours été chez les philosophes qui, au cours des siècles précédents, se sont préoccupés d’éthique.
Les choses se gâtent un peu au tournant du XXe siècle. Sous l’influence de penseurs néfastes et faux qui ont imaginé d’attribuer un caractère contingent à la loi morale, s’est peu à peu créée une opposition stupide, mais étrangement tenace, entre le camp des conservateurs et celui des progressistes. Au vrai la chose aurait pu se produire bien avant, sous l’influence délétère des « philosophes des Lumières » ; mais ces soi-disant philosophes étaient d’un étiage intellectuel trop restreint pour exercer une influence réelle sur des créateurs d’un certain niveau, et le magnifique élan romantique n’eut aucun mal à les réduire en poussière. Marx et Nietzsche étaient, il faut en convenir, d’un autre calibre que Voltaire et La Mettrie. Ainsi, un doute moral s’est installé, y compris chez les meilleurs, sur des questions pourtant peu douteuses. Il s’est principalement focalisé sur les questions sexuelles, et la faute en revient largement, il faut l’admettre, aux conservateurs. La pruderie victorienne est un phénomène incompréhensible, exagéré, qui ne s’était jamais vu (et ne se reverra jamais), il n’est donc pas surprenant que ce soit en Angleterre que la confusion ait été la plus grande. Elle donne des résultats magnifiques chez Galsworthy, injustement oublié (l’immortalité me paraît assurée à un auteur qui a su créer le personnage de Soames Forsyte). Mais c’est sans doute chez Somerset Maugham que ces questions morales atteignent leur plus haut point de tension, et aboutissent aux réalisations les plus bouleversantes. Maugham, sans doute par pudeur, s’était créé un personnage de vieux pédé raffiné et cynique. Alors que d’abord il n’a pas toujours été vieux, qu’il n’a pas été exclusivement pédé (sa descendance en témoigne), et que son cynisme affiché dissimulait des manifestations de générosité pratique très réelles. Il se livre bien davantage dans ses livres. Les êtres aimés ne sont pas toujours ceux qui en seraient dignes ; cette vérité désolante et banale, il ne parvient absolument pas à s’en accommoder. Le désir est naturel et sain, c’est la nature qui parle, il se refuse à y renoncer ; mais aussi il aimerait tellement que les braves gens soient heureux, que leur aspiration à l’amour soit comblée, et naturellement ce n’est pas possible, et tout cela nous donne, notamment dans L’Envoûté et dans Le Fugitif, quelques-unes des plus belles pages de la littérature anglaise.
Plus on avance dans le XXe siècle, plus la confusion augmente, et plus la loi morale perd du terrain, jusqu’à n’être finalement plus du tout comprise, quand elle n’est pas systématiquement dépréciée. L’adage : « On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments » aura finalement eu un impact négatif considérable. Il me semble même que l’invraisemblable surestimation dont les auteurs collabos sont depuis longtemps l’objet y trouve son origine. Entendons-nous bien, Céline n’est pas sans mérite, il est juste ridiculement surévalué. Et les Poèmes de Fresnes de Brasillach sont très beaux, d’une beauté surprenante même chez un auteur aussi faible. Mais tous les autres, les Drieu, Morand, Félicien Marceau, Chardonne… quand même une assez lamentable brochette de médiocres. Eh bien, il me semble que leur étrange surestimation tire son origine d’une accentuation perverse de l’adage précité, qui pourrait se formuler ainsi : « Si c’est un salaud, c’est probablement un bon auteur. »
C’est dire l’étrange chaos auquel nous étions parvenus. Ce qui ne fait que souligner les immenses mérites d’Emmanuel Carrère. Dès qu’on rentre dans l’un des livres (et il est à peu près le seul de sa génération dont on puisse le dire), les miasmes du doute moral s’évaporent, l’atmosphère devient plus claire, la respiration se fait plus ample. Carrère sait quand le comportement de ses personnages est estimable, admirable, odieux, moralement neutre ; il peut avoir des doutes sur tout, mais pas sur ça. Et c’est cette clarté de conception, cette droiture intellectuelle et morale qui le rendent capable, lui et lui seul (ou à peu près), d’aborder certains sujets, en effet moralement délicats. On ne louera jamais assez, par exemple, sa peinture de Jean-Claude Romand dans L’Adversaire. Que Jean-Claude Romand soit un assassin odieux, qu’il mérite largement la peine qui le frappe, nul ne songera à le nier ; mais qu’il soit très loin de présenter une image crédible du mal, c’est non moins certain, et c’est là où le talent d’Emmanuel Carrère se manifeste à plein. Il est réellement remarquable de voir comment il réussit peu à peu à nous rendre Romand proche, et même sympathique, sans jamais se permettre la moindre compromission sur la question du mal.
(Romand est, par ailleurs, hautement significatif. Une des qualités les plus importantes, et les plus rarement évoquées, du romancier est de savoir choisir ses sujets. Il faut réfléchir, réfléchir longtemps ; puis viser, viser avec tout le soin suffisant, et tirer en plein centre. Des causes criminelles il y en a des centaines par an, et les assassinats de famille comptent pour beaucoup dans la liste ; mais choisir pour cible un personnage qui, dans sa mythomanie, a choisi de se faire passer pour un médecin humanitaire, et même pour un « grand nom de l’humanitaire », voilà qui en dit long sur notre société.)
Limonov est l’incarnation d’un problème plus ancien, mais non moins délicat. Que Limonov ait eu du talent, c’est peu contestable ; mais qu’il ait par ailleurs été, à certains égards, franchement un salaud est tout aussi évident. Il est passionnant de comparer le traitement par Emmanuel Carrère du cas Limonov et celui, par Somerset Maugham, du cas Gauguin. Maugham a pour Gauguin une admiration infinie, il le considère (avec un peu d’exagération sans doute, mais passons) comme un génie du calibre de Michel-Ange ; mais la brutalité et l’égoïsme qu’il manifeste dans sa vie privée lui soulèvent le cœur. Le martyre de Dirk Stroeve, un des êtres dont la vie fut brisée par Gauguin, lui tire des pages hallucinées de douleur ; mais en même temps il ne peut pas condamner Gauguin, ce serait trop lui demander, et il souffre, le pauvre Maugham, il souffre de plus en plus, au point que c’est sa souffrance d’auteur qui devient le véritable sujet d’un livre superbe, mais d’une lecture éprouvante. Carrère à l’inverse ne s’étonne nullement qu’un écrivain talentueux soit également un salaud ; il le déplore, il préférerait qu’il en soit autrement, mais cela ne fait pas partie pour lui des contradictions insoutenables ; c’est juste un de ces étranges tours que la nature se plaît à manigancer lorsqu’elle façonne les hommes. Son point de vue sur ce sujet est celui de Shakespeare ; et, au-delà, de tous les classiques.
Cette santé et cette clarté du point de vue d’Emmanuel Carrère ont pour corollaire un mérite qui, pour être négatif, n’en est pas moins considérable, c’est qu’il ne se pose jamais de faux problèmes.
Ce n’est jamais sans un serrement de cœur que je vois des penseurs chrétiens (ou peut-être des moines chrétiens, enfin des chrétiens) se poser, avec gravité et douleur, le « problème du mal ». Quel problème du mal ? S’il y a une entité qui est chez elle dans le monde, qu’on y retrouve sans surprise, dont l’existence est tout sauf problématique, c’est bien le mal.
Et ce m’est toujours un léger agacement d’entendre louer la « profonde connaissance de la nature humaine » manifestée par tel ou tel auteur qui n’a fait, au cours de sa longue carrière, qu’aligner une peu ragoûtante théorie de personnages égoïstes et cyniques. Un tel auteur, il me semble, n’a au contraire manifesté qu’une bien superficielle compréhension du cœur humain. Car certains êtres, de manière consciente et délibérée, décident de traiter constamment les autres avec loyauté, honnêteté et bonne foi ; puis se conforment, jusqu’à leur mort, à cette maxime. D’autres encore, sans y être aucunement contraints, se portent hardiment au secours des autres, et s’efforcent de leur mieux de les secourir, et d’alléger leurs souffrances. Le bien existe, il existe absolument, tout autant que le mal. Et c’est cette existence, absolument contraire à toute loi naturelle, cette existence contreproductive du point de vue biologique, qui pose réellement problème. Et c’est ce problème du bien, le seul peut-être qui vaille, qu’Emmanuel Carrère se pose dans les plus belles pages de ces livres. Pourquoi Étienne Rigal, jeune espoir du Syndicat de la Magistrature, a-t-il choisi, plutôt que la voie dorée d’un cabinet ministériel, de devenir juge d’application des peines à Béthune ? Pourquoi a-t-il décidé de venir en aide à des miséreux alcooliques et semi-dégénérés ? Pourquoi ?
Pour reprendre le sujet sous un angle un peu différent, il me semble que la question de la communauté humaine, de la possibilité d’une communauté humaine, est celle qui revient de la manière la plus insistante dans les livres d’Emmanuel Carrère. Cioran note avec brièveté que la croyance en Dieu « était une solution », et qu’on n’en trouvera certainement jamais de meilleure. Parmi les immenses avantages de cette croyance, j’en repère au moins trois. Un, les questions cosmologiques sur l’origine de l’Univers, de l’espace, du temps, etc., se trouvaient ipso facto résolues. Deux, la mort était vaincue (la sienne, et surtout celles des autres). Trois, la possibilité d’une communauté humaine était constituée (vous les reconnaîtrez à ce signe qu’ils s’aiment les uns les autres, etc.) Il m’a toujours semblé que, de ces trois points, celui qui tenait le plus à cœur à Emmanuel Carrère, qui expliquait le mieux sa fascination renouvelée pour le christianisme, c’était le troisième. La plus impressionnante illustration en est sans doute l’extraordinaire avant-dernière page du Royaume, celle où, dansant aux côtés d’Élodie la jeune mongolienne, dans la communauté de l’Arche de Jean Vanier, envahi par les larmes il entrevoit, il entrevoit vraiment ce que c’est, le Royaume.
Sur cette question de la communauté humaine, je me sens largement moins éloquent, et plus contradictoire. Perméable au dernier degré à l’émotion collective, je ne me suis jamais senti aussi proche de la croyance que lorsque j’assistais à une messe. Mais, aussi, toutes les messes si je puis dire ne se valent pas, et c’est lorsque la célébration intervient à l’occasion d’un enterrement que le rêve chrétien me perturbe au plus haut point. La dernière à laquelle j’ai participé avait lieu en l’honneur de Bernard Maris. Emmanuel était là, lui aussi (et il a très bien parlé de notre ami assassiné). Je me souviens de cette certitude, de cette évidence qui émanaient des paroles du prêtre : non, la mort n’existe pas, elle n’existe absolument pas, ne pleurez pas petits enfants, Christ a vaincu la mort. Ça me met dans des états nerveux pathétiques, cette certitude.
Peut-être aussi que la question de la communauté humaine en général m’intéresse moins parce que je m’intéresse passionnément à cette communauté plus restreinte composée par un homme et une femme. Emmanuel Carrère s’y intéresse beaucoup lui aussi, l’amour tient une place considérable dans nos livres, a tous les deux (il insiste de manière très émouvante sur l’amour conjugal, sur la sexualité conjugale aussi). Mais la question de la communauté humaine en général, il n’y a pas renoncé. Moi, je dois en convenir, si ; et ce que le mot de « fraternité » m’inspire en premier lieu, c’est une certaine défiance. Je suis très loin de m’en vanter ; je constate. Je constate mes défaillances, mais je ne veux pas les exagérer ; mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du royaume restreint. Je crois à l’amour.
C’est une promesse bien modeste, comparée à la promesse du Royaume ; un amour bien restreint, comparé à la charité dont parle Saint Paul ; mais il m’arrive de penser que c’est, peut-être, suffisant. Je ne sais pas ce qu’en pense Emmanuel Carrère, je ne suis pas sûr qu’il le sache lui-même ; mais je sais qu’on a le droit de le lui demander, moi comme tous ses lecteurs (aussi pénible que cela puisse être, les écrivains s’exposent à cela : leurs lecteurs ont le droit, absolument le droit de les sommer de s’expliquer sur la manière dont il convient de vivre). Bref, sans connaître la réponse d’Emmanuel Carrère, je crois l’avoir suffisamment lu pour savoir qu’il appréciera cette phrase que j’emprunte à Versilov (un des personnages les plus énigmatiques de Dostoïevski, parce qu’étrangement dénué d’hystérie) :
« Quant à faire obligatoirement le bonheur d’au moins une créature au cours de sa vie, mais de le faire pratiquement, c’est-à-dire effectivement, je l’érigerais en commandement pour tout homme cultivé, exactement comme je pourrais faire une obligation à tout paysan de planter au moins un arbre dans sa vie, étant donné le déboisement de la Russie. »