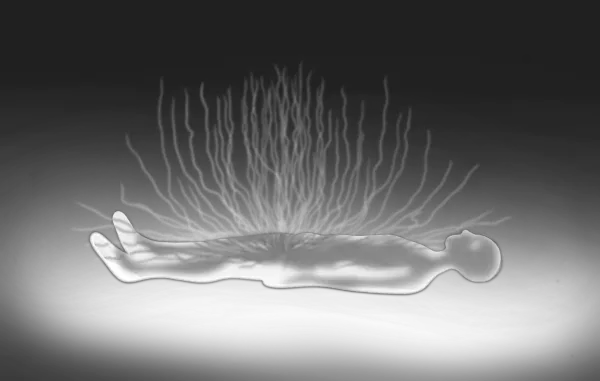La privatisation du monde
Sur 99 francs de Frédéric Beigbeder.
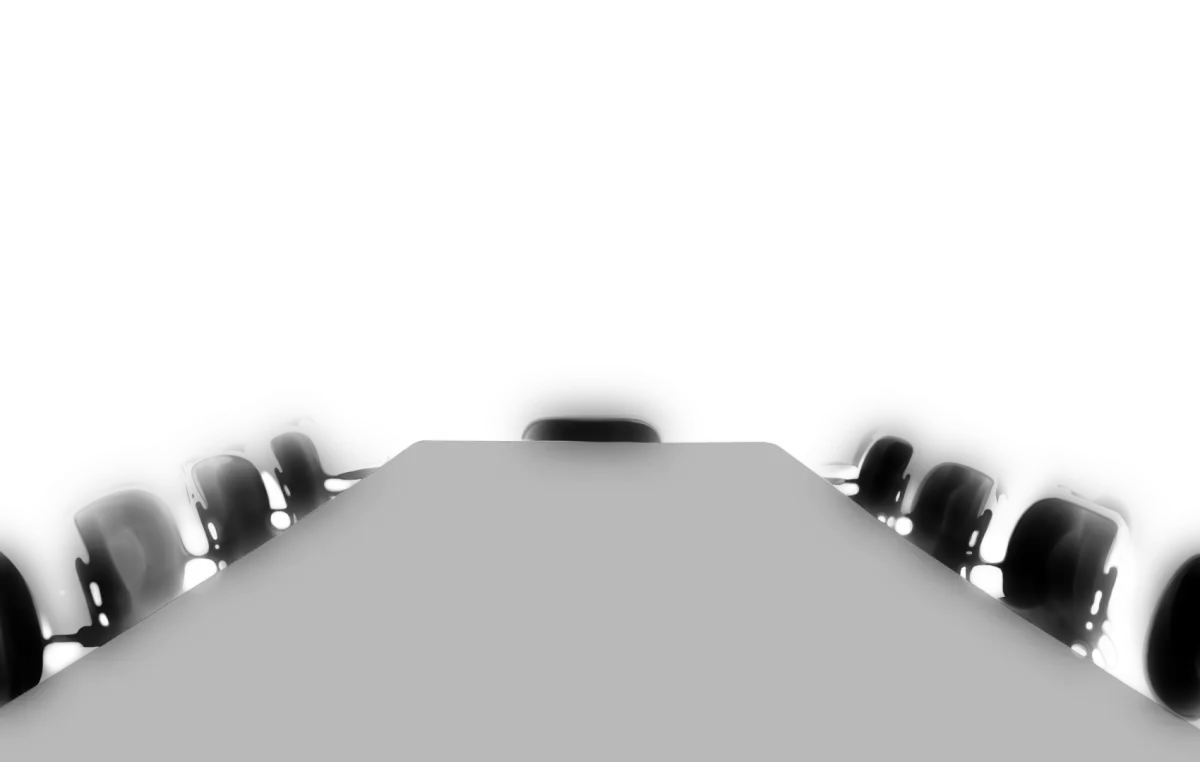
Les best-sellers américains (je veux parler de ceux qu’on trouve dans toutes les librairies du monde, de Prague à Manille ; de ceux qui sont achetés par Hollywood avant même leur sortie, et qui génèrent des bénéfices se chiffrant en millions de dollars) sont généralement des livres médiocres. Les personnages sont plats et artificiels, le style inexistant, le suspense vite éventé ; ils ont cependant une qualité qui manque à la plupart des livres français : la précision et le réalisme dans la description milieux professionnels. On sent à lire ses livres que John Grisham a effectivement été avocat, et pendant de nombreuses années ; que Robin Cook a été médecin et chirurgien, qu’il a travaillé dans des hôpitaux, des laboratoires, des cliniques privées.
Frédéric Beigbeder travaillé pendant une dizaine d’années chez Young & Rubicam, c’est-à-dire dans la filiale française du plus grand groupe de publicité mondial. Comme son personnage Octave, il était concepteur-rédacteur (c’est-à-dire qu’il imaginait des campagnes publicitaires, et rédigeait leurs slogans). Un tel métier − ne serait-ce que par les frustrations qu’il induit − peut prédisposer à l’écriture romanesque ; il est donc surprenant de ne pas avoir plus de romans nous décrivant de l’intérieur la vie d’une agence de pub − les raisons de cet état de choses apparaîtront un peu plus tard. Par exemple, le titre du livre, 99 francs est un concept (un concept pertinent, voire génial : donner comme titre à un livre son prix de vente, c’est exprimer avec franchise la nature d’un monde où la réalité ultime c’est l’argent). Le titre du roman précédent de Frédéric Beigbeder, L’amour dure trois ans, s’apparentait plutôt à un slogan (un slogan qui contenait une grande part de vérité ; ce qui est inutile dans la pub, préférable dans un recueil d’aphorismes, indispensable dans le cas d’un roman).
99 francs regorge de prouesses sémantico-verbales, il y en a presque à chaque page ; ma préférée est peut-être cette phrase, très belle : « Le proctérien n’a pas ri ». Tout cela appartient au roman ; pourrait-on trouver l’équivalent dans la pub ? Non. La publicité peut-elle être brillante, talentueuse, émouvante, drôle, géniale ? Non. Les créatifs des agences de pub, c’est une des évidences qui ressortent de ce livre, se méprisent eux-mêmes ; ils sont conscients de faire de la merde, et de n’être que des créatifs ; ce qu’ils aimeraient, eux, c’est être des créateurs (écrire vraiment des livres, réaliser vraiment des films, ou bien peindre, etc.) En tant que créatifs, ils peuvent cependant se permettre de mépriser leurs collègues, les commerciaux. Ceux-ci, à leur tour, méprisent les clients − à qui ils arnaquent journellement des sommes considérables. Quant aux clients, de toute façon ils peuvent faire jouer la concurrence et, de ce fait, ils méprisent indistinctement les agences de pub.
Ces petits mépris particuliers sont pris dans une chaîne de mépris plus générale ; les directeurs généraux des multinationales ne méprisent pas seulement leurs employés, mais également les consommateurs, à qui ils vendent volontairement des produits de mauvaise qualité (programmation de l’obsolescence) ; mais ils sont à leur tour méprisés par les actionnaires, pour lesquels ils travaillent ; ces actionnaires sont eux-mêmes des consommateurs, et souvent des employés.
Comme dans toutes les entreprises du monde, ces gens qui se méprisent doivent se rencontrer au cours de réunions afin de réaliser leur objectif commun : engendrer chez le consommateur un désir suffisamment puissant pour, dans un premier temps, provoquer l’achat ; dans un deuxième temps, compte tenu de la violence du désir initial et de la qualité maintenue suffisamment basse du produit, créer chez le consommateur une « déception post-achat » suffisante pour permettre l’émergence d’un nouveau désir, sans pour autant entacher gravement l’image de la marque.
La narration de ces réunions est une des meilleures réussites du livre : de fait, les forces conjointes du marketing et de la publicité ont réussi à créer un jargon auprès duquel celui de l’informatique et des start-up Internet devient presque limpide. Un paragraphe du dialogue, à titre d’exemple :
Nous avons trouvé un concept fédérateur qui, je crois, tout en collant à la copy-strat, permet vraiment de conférer un maximum d’impact à la promesse produit, notamment au niveau du code visuel.
Comme les lecteurs, les personnages du livre traversent réunions et séances de travail dans un état de compréhension flottante, avec un demi-rire nerveux ; c’est ça, la modernité. De toute façon, ils sont là pour la thune. Une de mes pages préférées est basée sur un principe étonnamment simple : cela se passe autour d’un buffet, à l’occasion des Oscars de la publicité à Cannes ; sont simplement citées les personnes présentes, leur niveau hiérarchique dans l’agence, la marge brute de l’agence en millions de francs. Là aussi, l’enseignement est limpide : dès qu’on cite des sommes d’argent, on obtient, mécaniquement, une augmentation de l’effet de réalisme ; cette augmentation est proportionnelle à l’importance de la somme.
Octave, notre pauvre petit héros au cerveau rongé par le stress, la cocaïne et les désirs sexuels inassouvis (car la concurrence est encore rude, au niveau intermédiaire qui est le sien ; nous ne sommes pas encore dans l’univers de Glamorama), Octave ne souhaite nullement faire partie du club des plus grosses fortunes mondiales. Tout ce qu’il demande à la vie, c’est de pouvoir finir ses jours dans une île tropicale, en compagnie de deux putes bronzées aux orifices accueillants. Pour ce faire, il a mis au point le plan suivant : écrire un roman réaliste (où tous les personnages, donc, apparaîtront comme des salauds et des cons) se déroulant dans l’univers de la pub. Dès la parution de l’ouvrage il sera renvoyé, non sans avoir touché de confortables indemnités de licenciement qui lui permettront de réaliser son rêve (par exemple aux Seychelles, où les putes sont jolies et bon marché).
Vers la moitié du livre, Octave est pris d’un doute ; la publicité, depuis ses origines, a manifesté un talent inouï pour la récupération de l’insoumission, la provocation, la révolte. Elle s’adresse avant tout aux jeunes, ou plutôt elle présuppose chez son récepteur un état de jeunesse permanent. Tout ce qui est de l’ordre de l’interdit, de la transgression est en mesure d’attiser le désir et constitue donc un matériau de choix pour la récupération publicitaire. Il est probable qu’Octave, loin d’être renvoyé pour son brûlot anti-pub, sera au contraire félicité par ses supérieurs ; qu’il bénéficiera, dès la parution du livre, d’une augmentation et d’une promotion substantielles ; il pourra monnayer cher sa révolte. Ce qu’il advient ensuite dans le livre, je vous laisse le découvrir.
Dans la vie réelle, le directeur de Young et Rubicam − France a réussi à prendre connaissance des épreuves (comment ? on peut se le demander). Dans la vie réelle, Frédéric Beigbeder a été licencié pour faute grave, selon la procédure dite de mise à pied (avec départ dans l’heure, et sans indemnités de licenciement). Cela sans exclure la possibilité d’un référé pour bloquer la sortie de l’ouvrage.
À ce stade, on ne sait plus vraiment comment qualifier 99 francs. Autofiction prospective ? En tout cas, on a affaire à un objet d’un type nouveau ; de fait, le livre semble fonctionner comme une sorte de positif expérimental : on décrit une situation proche de la vie réelle, incluant l’écriture d’un livre, on essaie de savoir comment elle peut évoluer. Le moment de l’expérience, c’est la réception du livre par son public ; les modifications intervenues dans la vie réelle de l’auteur valideront, ou non, l’hypothèse de départ. C’est ainsi que progressent les sciences sociales.
Au moment où j’écris ces lignes, il semble que l’hypothèse de Frédéric Beigbeder (la publicité peut digérer et réutiliser à son profit n’im porte quelle transgression) se soit révélée fausse. On peut s’amuser avec des bonnes sœurs, des bites, des yeux crevés, des sidaïques, des chambres à gaz : no soucy ; mais il y a une limite à ne pas franchir. Laquelle ? Difficile à dire. L’interprétation la plus vraisemblable semble celle-ci : Frédéric Beigbeder a porté atteinte à l’image de marques, déposées et protégées par le code de la propriété industrielle ; il a ainsi commis une erreur grave, irréparable aux yeux du client ; il s’est en outre placé dans une position judiciaire difficile ; son sacrifice est devenu à la fois nécessaire et possible.
Les avocats de Grasset avaient pourtant pris certaines précautions. Young & Rubicam avait été remplacé par Rosserys & Witchcraft, Danone par Madone. Ces précautions se sont avérées insuffisantes, ce qui est tout de même impressionnant (car après tout « madone » est un nom commun, appartenant au vocabulaire courant ; Danone aurait-il réussi à privatiser la Vierge ?). S’ils se réveillent un peu ces derniers temps, les catholiques restent encore loin du niveau d’abjection et de violence atteint par leurs collègues musulmans ; je pense donc qu’il reste possible, sans danger majeur, d’enculer la Sainte Vierge dans un roman. Pour un yaourt, je me demande. Osons, à titre de test, le paragraphe suivant :
« Avant de lécher le cul des petites filles qu’il venait de capturer, Marc Dutroux aimait à verser sur leurs anus du yaourt liquide au bifidus DANONE. Il avait essayé avec du YOPLAIT ou du CHAMBOURCY, mais non : l’acidité était trop prononcée, le goût donné aux sécrétions anales manquait de finesse ; et tous ses amis pédophiles étaient du même avis. Pour ses gang-bangs de petites filles, décidément, Marc restait fidèle à DANONE. »
Dans le dernier numéro de La Nouvelle Revue française, Dominique Noguez note avec justesse que le roman contemporain tend de plus en plus à procéder « par collages ou par ready-made, par absorption de lieux, de rues, de magasins, de marques, d’événements, de personnes de la vie réelle ». Il observe également que le monde réel, pris dans un mouvement accéléré vers la privatisation de tout, se défend avec une vigueur croissante ; qu’il intente des procès à n’en plus finir ; et que, généralement, il les gagne.
Il est peu vraisemblable que le « monde réel », enhardi par ses premiers succès juridiques, renonce à son attitude agressive. Il est peu vraisemblable également que les écrivains cèdent ; au contraire, on peut s’attendre les voir se mettre hors la loi de manière de plus en plus précise, délibérée et violente. Toutes les conditions sont donc réunies pour une véritable lutte à mort, dans laquelle je me sens partie prenante. Il y a peu de points communs entre Jean-Marie Le Pen, l’Espace du Possible, les Chiennes de Garde (organisation à laquelle appartient, je signale le fait pour sa cocasserie, l’irrésistible Monseigneur Gaillot), la LICRA, la famille Godard et Danone ; mais je sais que je considère dorénavant tous ces gens, indistinctement et au prix d’un amalgame rapide mais juste, comme des ennemis ; et que je me ferai une joie, à l’avenir, de les insulter, les diffamer, les calomnier, de porter publiquement atteinte à leur réputation, de leur infliger dans la mesure de mes moyens des dommages matériels ou moraux irréversibles. À eux, et à leurs semblables.
L’issue du conflit est incertaine. Il est vraisemblable que les éditeurs (comme, d’un autre point de vue, les producteurs de films) constitueront le maillon faible de la chaîne ; on peut difficilement leur en vouloir, compte tenu de l’existence en France de dispositions aussi évidemment scélérates que les lois Évin et Gayssot, compte tenu aussi de l’état effarant de la jurisprudence dans ce pays. Alors, quoi ? Les journaux ? Sûrement pas ; ils sont muselés, de manière simple et efficace, par leurs budgets de pub. Internet ? Ce serait une régression désolante par rapport au livre ; mais oui, peut-être, Internet, quand même. Il va bien falloir en passer par là, au moins pour les prochaines décennies.