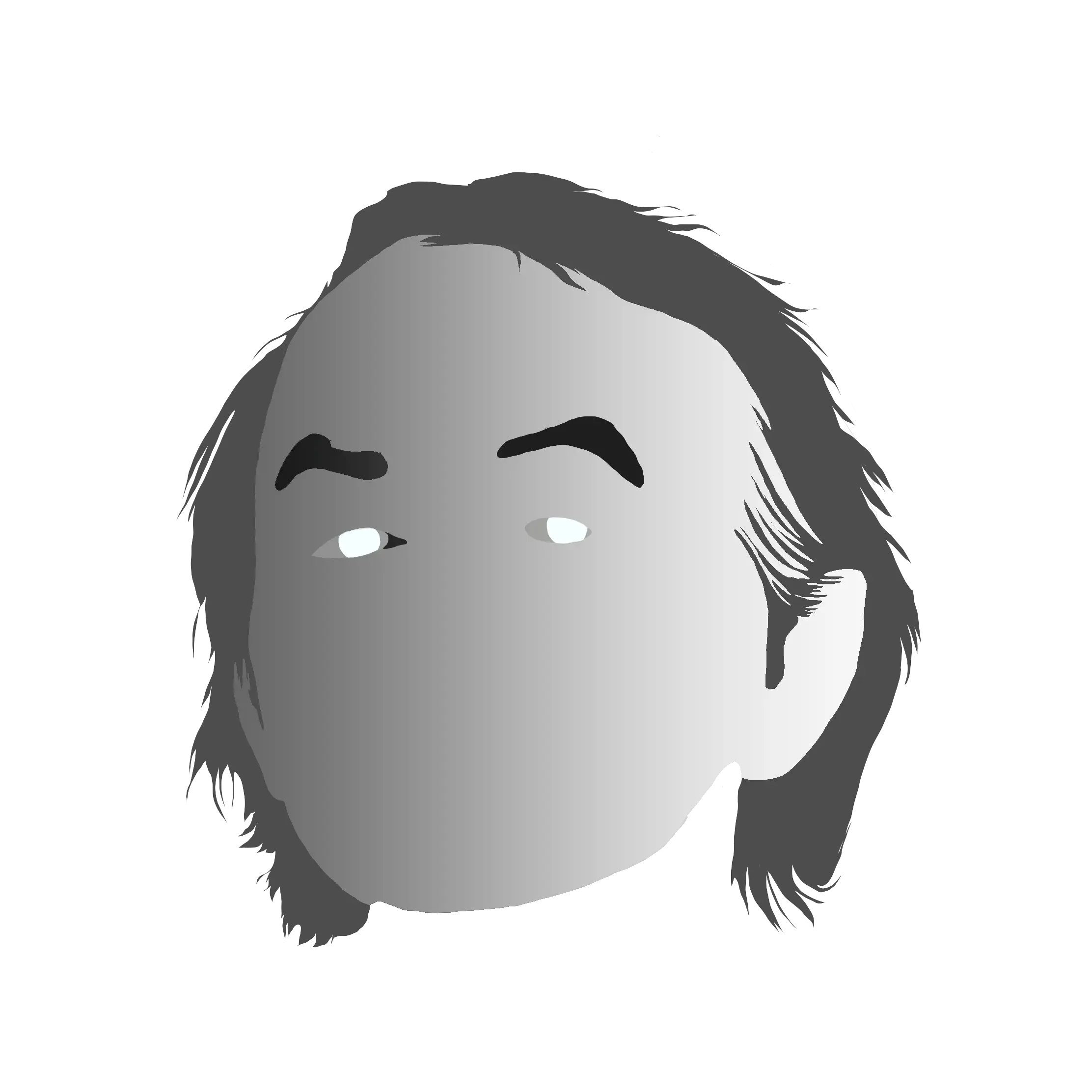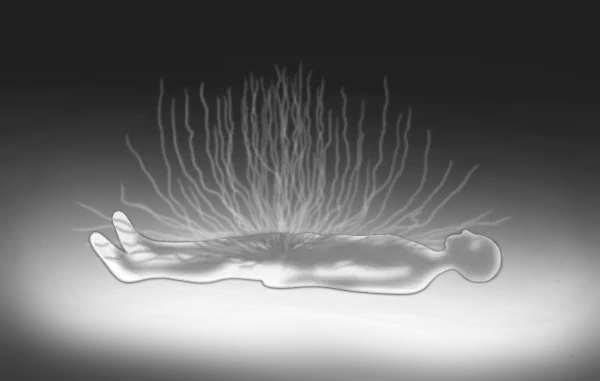Partout des images de sexe parfait
Bret Easton Ellis et Michel Houellebecq livrent un entretien à Der Spiegel à l'occasion de la sortie de leurs romans respectifs, Glamorama et Les Particules Élémentaires.
Der Spiegel : Monsieur Ellis, Monsieur Houellebecq, dans vos livres vous dépeignez tous les deux les excès de la sexualité et de la violence. Vous passez ainsi pour des superstars du mal, au-delà de toute critique littéraire. Ce jugement, vous fait-il de la peine ?
Michel Houellebecq : En France je suis plutôt considéré comme l’incarnation du politiquement incorrect.
Bret Easton Ellis : Je pourrais probablement expliquer dans un million d’interviews pourquoi tout cela est complètement faux et ça ne changerait rien. En Amérique justement, de nombreux lecteurs prennent ce que j’écris au pied de la lettre, ce qui explique ma réputation.
M. Houellebecq : Mes livres en revanche, ne sont pas pris suffisamment à la lettre. Au lieu de lire ce que j’ai écrit, mes romans sont classés dans des catégories préétablies. Par exemple, je critique le mal, mais les gens ne me prennent pas au sérieux.
Der Spiegel : Cela signifie-t-il que vous vous considérez en réalité comme des moralistes ?
B.E. Ellis : Quand on veut écrire sur les dysfonctionnements sociaux, on se place automatiquement sur le terrain de la critique et des valeurs. Je crois que chaque acte de création, que ce soit l’écriture, la peinture ou la réalisation d’un film, contient de la morale. Mais chez moi, la morale est plutôt le produit secondaire de la satire.
M. Houellebecq : Je crois que c’est assez légitime de nous qualifier tous les deux de moralistes. Mais les valeurs en question sont différentes. En Amérique, le sujet de la violence, dont traite justement votre roman American Psycho, est bien plus central qu’en Europe. La dictature de la jeunesse et le sens qu’on accorde à la richesse sont également des sujets propres à l’Amérique. Ainsi les auteurs américains écrivent avant tout sur les jeunes, les gens beaux et riches. Pour les Européens en revanche, il est convenable d’écrire sur des gens moyennement beaux, moyennement riches et d’âge moyen.
B.E. Ellis : Aux États-Unis, et en fait dans tout le monde occidental, nous sommes constamment bombardés par des images qui nous rappellent nos insuffisances. Cela nuit à notre société, car tous ceux qui ne sont ni riches, ni jeunes, ni beaux — ce qui est le cas de la majorité des gens — éprouvent inévitablement un sentiment d’insécurité.
M. Houellebecq : Plus je vois ces mannequins glamoureux dans les magazines, plus je me sens déprimé…
Der Spiegel : …parce que le système capitaliste, comme indiqué dans Extension du domaine de la lutte, divise la société entre gagnants et perdants sexuels : ceux qui sont beaux ont une vie sexuelle formidable, les autres sont « limités à la masturbation et à la solitude ». Cela serait-il suffisant de percer à jour le message transmis par les images pour se défier d’elles ?
B.E. Ellis : Non, moi aussi cela m’arrive de me faire avoir. Je me surprends moi-même à feuilleter les magazines et à regarder les mannequins en pensant : pourquoi je ne ressemble pas à ça ? Ensuite, je m’offre un verre. En ce qui concerne la question de la violence : lors de ma tournée européenne pour Glamorama, chaque journaliste, de l’Italie à la Hollande, m’a interrogé là-dessus ; en Amérique, pas un seul. J’imagine qu’aux États-Unis la violence fait tellement partie de la vie quotidienne, qu’on ne la voit même plus.
Der Spiegel : L’attitude envers la représentation de la violence n’a-t-elle pas changé depuis les épisodes de folie meurtrière dans les « high schools » américaines ? Oliver Stone, qui avait mis en scène le film violent Natural Born Killers, a renoncé en plein tournage à diriger American Psycho, craignant probablement pour sa réputation.
B.E. Ellis : Il faut être malade pour établir des parallèles entre des films comme Natural Born Killers ou des livres comme American Psycho et ces massacres. Cela masque ce qui se cache vraiment au fond de tels actes : les problèmes sociaux, la défaillance des parents, les drogues ; et le visage d’une société qui donne aux gens le sentiment d’être sans valeur.
Der Spiegel : Monsieur Houellebecq, dans vos livres la violence se manifeste avant tout dans le suicide.
M. Houellebecq : Je m’intéresse aux personnes issues d’un milieu différent, aux gens de la classe moyenne. Pour dépasser leurs limites personnelles, ils n’ont pas besoin d’aller aussi loin que le courtier Patrick Bateman dans American Psycho. Grâce à son statut social, Bateman s’est tellement élevé au-dessus de la moyenne américaine que le seul moyen de se dépasser est un acte extrême, comme la torture et le meurtre. Mes héros ne vivent pas dans le luxe, ils ne réussissent même pas à baiser. Par conséquent, tuer quelqu’un ne leur vient même pas à l’esprit. Quand dans Extension du domaine de la lutte, l’informaticien se rend compte que son associé Tisserand ne réussira jamais à coucher avec une femme, il lui propose de poignarder un couple d’amoureux. Ce dernier refuse car il veut du sexe et non assassiner des gens.
Der Spiegel : Pour le punir, Tisserand meurt peu de temps après dans un accident de voiture.
M. Houellebecq : À vrai dire, cela n’était pas censé être une punition. Seulement, je ne savais pas ce que je pouvais encore faire de ce personnage.
B.E. Ellis : Bonne réponse, je comprends tout à fait.
M. Houellebecq : D’ailleurs, je ne crois pas non plus que l’on puisse rendre responsable American Psycho d’un quelconque massacre, car il dépeint justement les souffrances provoquées par la violence. Il existe bien sûr de nombreux produits culturels qui représentent la violence comme quelque chose d’amusant, comme un jeu.
B.E. Ellis : En tout cas pour moi, il n’était pas question de s’amuser. La thèse que je défends dans American Psycho, c’est que l’on ne peut se faire catapulter d’un monde vidé de sentiments — où tout ce qui compte ce sont les apparences et les choses matérielles — que par un acte extrême tel que le meurtre.
Der Spiegel : American Psycho a été publié en 1991. Voyez-vous les choses toujours ainsi ?
B.E. Ellis : Non, pour moi il est même étrange de m’entendre dire ça maintenant. C’était la thèse d’un très jeune homme. Maintenant que je suis plus âgé, je pense que le sentiment ultime n’est pas la douleur, mais l’amour. Plus on a conscience de sa propre mort, plus l’amour devient important. Dans American Psycho Patrick Bateman se vante de ses meurtres grotesques de femmes, tandis que le personnage principal de Glamorama est dégoûté par la torture et le meurtre. Moi-même, j’éprouve plus de peur face à la violence aujourd’hui qu’autrefois.
Der Spiegel : Cela veut-il dire que si vous écriviez American Psycho aujourd’hui, vous seriez dégoûté par vos propres descriptions ?
B.E. Ellis : Dégoûté, je l’étais aussi à l’époque. Écrire ces scènes brutales et presque surréalistes m’a vraiment bouleversé, car dans mon imagination, j’ai commis tous les meurtres.
Der Spiegel : Monsieur Houellebecq, vous aussi, vous avez écrit vos romans avec un sentiment de dégoût ?
M. Houellebecq : Non, j’ai ressenti surtout de la honte. Je dis des choses qu’il n’est pas convenable de dire et je détruis peu à peu mon image. Mais en même temps, j’ai besoin de ça. Ce qui m’a tellement choqué dans American Psycho, et c’est là le lien avec mes livres, c’est que le personnage principal ne ressent quelque chose que dans l’acte violent et non pas dans l’acte sexuel. Ce qui m’intéresse, c’est de savoir pourquoi tant de gens ne ressentent plus rien lors de l’acte sexuel. Il me semble que l’Europe se rapproche ici des États-Unis.
B.E. Ellis : J’ai toujours eu l’impression que les Européens sont largement moins névrosés que les Américains en termes de sexualité. J’ai eu des relations sexuelles bien meilleures avec les Européennes qu’avec les Américaines. L’amour avec les Italiennes est merveilleux. Dans la culture américaine, on attache tant d’importance à la beauté physique qu’au final personne ne peut plus être content de soi. Le sexe est devenu comme une production cinématographique : on est le réalisateur et l’acteur principal et on se rend à une fête ou dans un club où l’on choisit l’actrice principale. Correspond-elle à l’idéal de beauté, qui est représenté sur la couverture de Vogue ? Correspond-elle à la valeur du marché ? Quand on se lance comme ça, on ne peut plus avoir de relations sexuelles naturelles, détendues et simples. En principe, le sexe est juste une fonction de base comme celle de manger et boire. Mais si on en fait une représentation théâtrale, il devient une expérience creuse.
M. Houellebecq : Je suis content que vous ayez eu d’aussi bonnes expériences sexuelles en Europe. Comme je m’intéresse à la situation du sexe en Europe depuis plus longtemps que vous, je dois malheureusement dire que la situation a empiré. Le sexe est bien mieux à Cuba.
B.E. Ellis : D’accord. J’ai trouvé la France aussi très décevante. En Italie, les gens sont très détendus concernant le sexe ; en Irlande, ils boivent trop pour y arriver. Mais je tiens à souligner que je ne suis pas du genre à changer fréquemment de partenaires.
M. Houellebecq : En ce qui concerne l’Irlande, je ne suis pas d’accord. Pour le sexe, c’est le bon moment là-bas parce que le catholicisme y est en recul.
Der Spiegel : Dans vos livres, Monsieur Houellebecq, les personnages principaux fantasment sur le sexe, mais n’y parviennent guère. Vos héros surestiment peut-être simplement l’importance du sexe ?
M. Houellebecq : Non. Le sexe est le meilleur moyen de se rapprocher d’un être humain. Et je pense que le sexe est la seule chose qui fonctionne encore à peu près dans notre société.
Der Spiegel : « Fonctionne encore à peu près » correspond dans votre nouveau livre, Les Particules élémentaires à deux histoires d’amour qui se terminent par un désastre : la psychiatrie, le cancer, le suicide.
M. Houellebecq : C’est vrai, il est très sombre. Dans Extension du domaine de la lutte il n’y a aucune lueur d’espoir : aucun des personnages n’a jamais de relations sexuelles. Dans Les Particules élémentaires, les personnages principaux vivent quelques expériences amoureuses positives, même s’il n’y a pas de happy end. Ce qui compte pour moi, c’est qu’il y ait presque une fin heureuse, il ne manquait vraiment pas grand-chose.
B.E. Ellis : Dans une société où l’on voit partout des images de sexe parfait et inatteignable, la sexualité perd son âme. Le sexe devient un symbole de statut social. C’est de là que vient le terme de « femme trophée » qui signifie qu’un homme a épousé une femme qui est convoitée par d’autres. Cela ne signifie pas pour autant qu’il aime cette femme.
Der Spiegel : Monsieur Houellebecq, vos personnages souffrent terriblement parce que le sexe et l’amour sont généralement séparés l’un de l’autre.
M. Houellebecq : Alors là, vous vous trompez complètement. L’histoire d’amour entre Bruno et Christiane dans Les Particules élémentaires commence sur le plan sexuel, et ils tombent amoureux l’un de l’autre lors d’un échange de partenaires dans un environnement totalement sexualisé : un club échangiste.
B.E. Ellis : Le problème majeur c’est que nous sommes de tout notre être des créatures sexuelles. Nous serions tous sûrement beaucoup plus actifs sexuellement et moins névrosés si la société et la religion n’avaient pas dressé des murailles et défini ce qui était acceptable et ce qui ne l’était pas. Des amis homos me racontent parfois à quel point il est normal et naturel pour eux d’aller dans n’importe quel bar et de partir avec quelqu’un cinq minutes plus tard pour faire l’amour. Les couples hétérosexuels en revanche vont d’abord aller manger quelque part et bavarder pendant des heures. Le choix du partenaire devient presque une mise en scène théâtrale.
Der Spiegel : À votre avis, Monsieur Houellebecq, la poursuite individuelle du bonheur n’explique-t-elle pas justement le tas de ruines des « particules élémentaires », incapable d’aimer et d’avoir une relation durable ?
M. Houellebecq : Tout à fait, c’est une impasse complète. Ce que dit Mr. Ellis est certes juste : les homos parviennent plus facilement à avoir des rapports sexuels que les hétéros. Mais en même temps les critères de jeunesse et de beauté sont encore plus rigides dans ce milieu.
B.E. Ellis : Pourtant, je crois que chez les gays, l’attitude envers le sexe est plus honnête et plus ouverte. Je ne crois pas que pour les femmes, l’apparence physique des hommes soit d’une importance primordiale. Mais dans notre société, ce qui compte malheureusement pour les hommes à la recherche d’une partenaire c’est l’apparence de la femme.
M. Houellebecq : Oui, les hommes ont des critères affreusement simples. Mais il me semble que les femmes européennes s’en rapprochent actuellement.
B.E. Ellis : En Amérique également.
M. Houellebecq : À mon avis, cette tendance arrive d’Amérique, le magazine Men’s Health connaît d’ailleurs un grand succès en France depuis six mois. C’est une orientation nouvelle, parce qu’après cinq échecs de publication journalistique celui-ci est le premier succès en ce genre.
B.E. Ellis : Je connais beaucoup de femmes qui achètent Men’s Health pour la beauté des corps. Elles peuvent ainsi se passer de la pornographie. L’idéalisation du corps masculin s’est répandue de manière fulgurante au cours de la dernière décennie. Je vois plus de panneaux publicitaires montrant des hommes attirants, torse nu, que des panneaux affichant des femmes. Le fait que le corps masculin soit maintenant objectivé de la même façon que celui de la femme n’est pas un progrès pour moi. Et en parlant avec des amies, des femmes tout à fait éduquées, je constate que leurs exigences par rapport aux hommes sont en train de changer fondamentalement. L’ironie c’est que dans les publicités le nouvel idéal masculin est très influencé par les stylistes homosexuels.
Der Spiegel : Mais chez vous deux, ce sont justement plutôt les femmes qui sont les objets et les victimes.
B.E. Ellis : Les miennes seront rapidement décapitées (il rit). Je plaisante.
M. Houellebecq : Aujourd’hui les hommes vieillissants prennent encore des femmes jeunes comme partenaires et les femmes plus âgées sont du coup les victimes. Mais je crois que cela va changer ; les femmes deviennent plus agressives.
Der Spiegel : Dans quelle mesure les expériences autobiographiques négatives ont-elles influencé votre écriture ? Vous, Monsieur Houellebecq, vous avez raconté qu’enfant, votre mère vous avait abandonné et avait rejoint des hippies.
M. Houellebecq : Je n’avais pratiquement pas de relation avec ma mère, j’ai plus ou moins oublié tout cela et je ne voudrais vraiment pas en parler.
Der Spiegel : L’une des scènes les plus terrifiantes dans votre roman Les Particules élémentaires c’est le moment où vos deux héros, les frères Bruno et Michel, se retrouvent auprès du lit de leur mère mourante. Leurs malédictions obscènes accompagnent son agonie.
M. Houellebecq : Mais c’est vraiment drôle ! Je l’ai écrit pour faire rire les gens.
Der Spiegel : Cela ne doit marcher qu’avec quelques lecteurs. Pour vous, Monsieur Ellis, c’est plutôt votre père qui semble avoir laissé un vide affectif. À quel point cela a-t-il influencé vos romans ?
B.E. Ellis : Mon père est mort en 1992. Même si je n’ai jamais écrit directement sur lui dans un sens autobiographique, je crois qu’il a influencé à plusieurs égards ma perception du comportement masculin. Ce qu’incarne Patrick Bateman a sûrement aussi quelque chose à voir avec mon père. Il venait initialement de la classe moyenne et a changé de façon choquante, après avoir gagné plein de thunes. Il se comportait comme si sa fortune lui donnait tous les droits : exercer un contrôle sur les gens et les harceler, boire de façon excessive, devenir violent, etc. Je pense que tous mes romans ont quelque chose à voir avec la liberté que donne l’argent, et avec la manière dont les gens abusent de cette liberté. Quiconque a suffisamment d’argent est capable de faire tomber toutes les barrières, il peut torturer, violer, donner la mort et même s’en tirer.
M. Houellebecq : Dans nos sociétés agissent, je le crois, trop de forces centrifuges et trop peu de forces centripètes.
Der Spiegel : Qu’est-ce que vous entendez par cela ?
M. Houellebecq : En France, les gens préfèrent, dès qu’ils peuvent se le permettre, vivre dans les pays en voie de développement, parce qu’ils ne sont plus heureux chez eux. Ils ne sont pas sexuellement actifs, le nombre d’endroits où ils peuvent encore fumer est de plus un plus restreint, leur vie les fatigue et les ennuie. Je ne connais personne qui vive en Occident sans y être obligé.
Der Spiegel : Une perception bizarre ! Où préféreriez-vous vivre ?
M. Houellebecq : J’aime la Thaïlande et je vais souvent là-bas. Actuellement je vis en Irlande, parce que j’aime les pays avec de beaux paysages.
B.E. Ellis : Je pense que vous vivez en Irlande parce que c’est un paradis fiscal pour les artistes. En ce qui concerne le sexe, l’Irlande est plutôt à éviter. Peut-être la bière irlandaise vaut-elle le détour.
Der Spiegel : Monsieur Houellebecq, dans votre nouveau roman vous dites que nous assis — tons au suicide de la civilisation occidentale. Cette vision apocalyptique a-t-elle à voir avec le prochain changement de millénaire ?
M. Houellebecq : Je ne pense pas que nous devrions attacher trop d’importance au calendrier. Mais pour le reste, vous avez raison : oui, je crois que la fin est proche.
Der Spiegel : À la fin de votre livre, vous présentez la vision d’une humanité clonée, qui, dans le prochain millénaire aura gommé la division du genre et des deux sexes et tous les problèmes et les souffrances de l’individu.
M. Houellebecq : Ceci est une hypothèse, de la science-fiction.
Der Spiegel : Sa réalisation, vous paraît-elle souhaitable ?
M. Houellebecq : C’est une bonne idée, justement parce que je suis convaincu que l’humanité ne pourra jamais accepter la mort. D’ailleurs, dans l’Antiquité on nourrissait déjà le rêve d’êtres hermaphrodites que les hommes et les femmes ne fassent qu’un.
Der Spiegel : Monsieur Ellis, tandis que les critiques conservateurs sont scandalisés par vos romans, ceux de gauche ont loué votre critique formidable de la société. Votre compatriote Norman Mailer a dit de Patrick Bateman, le boursicoteur rusé d’American Psycho, que jamais une figure de la classe dirigeante n’avait été dépeinte d’une manière aussi répugnante. Vous considérez-vous comme un écrivain politique ?
B.E. Ellis : Je réagis avec mes livres aux développements de la société qui me déplaisent, mais je me décrirais plutôt comme quelqu’un d’apolitique. Patrick Bateman incarne à-peu-près tout ce que je trouvais d’horrible en Amérique quand j’écrivais ce livre. Il en va de même pour Victor Ward, le héros de mon livre actuel Glamorama. On écrit un roman pour des raisons très personnelles.
Der Spiegel : Et non pour changer le monde ?
B.E. Ellis : Je ne pense pas que ce soit possible. J’écris le roman que je veux lire. L’écriture est une expression créative personnelle — un hobby et non pas un métier, ni une carrière. Bien sûr, on reçoit des réactions sur un livre, et même d’une variété déconcertante, mais ce n’est pas la raison pour laquelle on écrit. Le côté intéressant de la lecture, c’est qu’elle est une expérience démocratique typique : chaque lecteur a le droit d’avoir sa propre réaction émotionnelle immédiate. Même si je donne beaucoup d’interviews explicatives, mes livres mènent leur vie propre.
Der Spiegel : Monsieur Houellebecq, pourquoi écrivez-vous ?
M. Houellebecq : Mon premier roman, je l’ai écrit, parce que je vivais précisément dans ce genre de monde informatisé qui y est présenté, et parce que je n’avais retrouvé cette réalité dans aucun autre livre. Mais comme mon premier roman ne me satisfaisait pas à certains égards, j’ai écrit le deuxième. En tant qu’écrivain, je veux refléter le monde.
Der Spiegel : Vous vous considérez comme quelqu’un d’apolitique comme Monsieur Ellis ?
M. Houellebecq : Les idées politiques font partie intégrante du monde.
B.E. Ellis : Vous exprimez cela de manière plus concise et plus pertinente que moi.
Der Spiegel : Vous semblez être d’accord sur bien des points. Et pourtant, vous, Monsieur Houellebecq, vous avez déclaré récemment dans un entretien qu’en tant que Français vous vous situiez à un niveau plus élevé que les Américains.
M. Houellebecq : Ce que je voulais dire c’est que le niveau d’un Américain moyen est inférieur à celui d’un Européen moyen.
B.E. Ellis : Je vois ça de la même façon.
M. Houellebecq : En théorie, les écrivains américains devraient être meilleurs que les écrivains européens.
Der Spiegel : Pourquoi ?
M. Houellebecq : Parce que le pays est pire.
B.E. Ellis : Je suis d’accord avec ça.
Der Spiegel : Et en pratique ?
M. Houellebecq : En pratique, le niveau moyen de la littérature américaine est plus élevé que celui de la littérature européenne.
B.E. Ellis : Ça aussi, c’est tout à fait exact.
M. Houellebecq : Je pense que cette situation a à voir avec le fait que le roman reflète avant tout le malheur du monde.