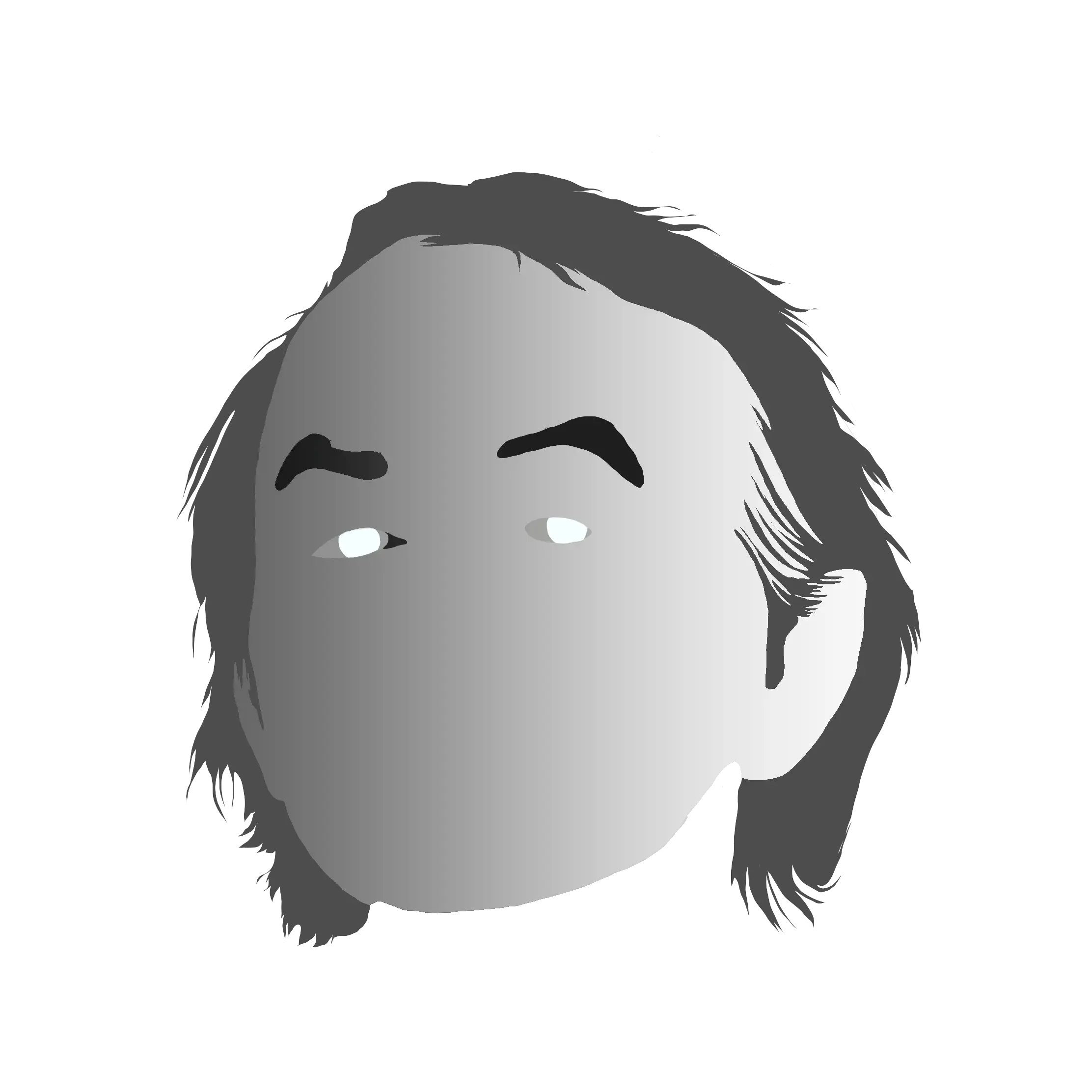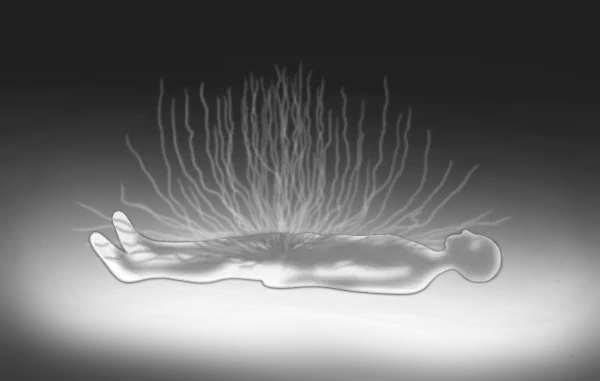Zone dépressionnaire

En 1996, Michel Houellebecq est l’un des rares à se colter au réel, que ce soit à travers le roman ou l’écriture poétique, comme en témoigne son recueil Le Sens du combat. Une ambition de dire le monde tel qu’il est, avec ses mensonges et ses lâchetés, son désespoir et sa vanité, mais aussi une nécessaire résistance dont l’écrivain retrace ici l’origine.
Michel Houellebecq — J’ai dû commencer à écrire vers 13 ans. J’achetais des cahiers de 288 pages — je me souviens du chiffre parce que c’était des multiples de 96 pages : 96 192 288… Donc, j’achetais des cahiers de 288 pages que je remplissais entièrement. Quand ils étaient pleins, j’allais vers la rivière la plus proche, je respirais seize fois et je les jetais dans l’eau. Seize, ça me paraissait un bon chiffre, j’avais l’impression qu’après ça je serais quelqu’un d’entièrement neuf.
Qu’écrivais-tu ?
Oh, je ne sais plus. J’essayais de formuler des idées sur la meilleure manière d’organiser le monde, je suppose — parce que visiblement c’était très mal organisé… Au bout de quelques années, j’ai fini par me lasser. Mais j’étais obstiné, c’est un trait de mon caractère, ce qui fait que j’ai jeté beaucoup de cahiers avant de m’apercevoir que ça ne changeait pas grand-chose. La vie m’apparaissait sous un jour très négatif. Les autres me terrorisaient. Je n’étais pas le seul d’ailleurs, et ils me terrorisaient à juste titre. J’étais interne, dans l’internat dont parle Girodias dans ses Mémoires, l’internat de Meaux, où l’on mettait généralement les enfants que les parents avaient du mal à contrôler. J’y étais entré en sixième, j’étais donc un petit dans un environnement où les garçons plus âgés se rassemblaient en meutes dans le but d’attraper les petits, de les frapper, les torturer, les humilier. Je vivais dans la terreur. Je m’étais acheté un couteau pour me défendre, je n’ai eu à m’en servir qu’une fois. Le type était étonné de voir son sang couler, ce qui m’a laissé le temps de prendre la fuite. Plus tard, j’ai trouvé des protecteurs, des garçons de terminale. Je ne sais pas pourquoi, ils semblaient apprécier ma conversation, ils m’invitaient à leur table.
Et tes parents ?
Mes parents ont divorcé très tôt, dès le début des années 60 — je ne suis même pas certain qu’ils aient jamais vécu ensemble. Ils m’avaient laissé à la charge de mes grands-parents, si bien que je les ai très peu vus pendant mon enfance. En un sens, c’était des précurseurs du vaste mouvement de dissolution familiale qui allait suivre. J’ai grandi avec la nette conscience qu’une grave injustice avait été commise à mon égard. Ce que j’éprouvais pour eux était plutôt de la crainte en ce qui concerne mon père, et un net dégoût vis-à-vis de ma mère. Curieux qu’elle ne se soit jamais rendu compte que je la haïssais. Je suis parti plusieurs fois en vacances avec elle. Elle menait une vie errante, travaillant peu, gagnant beaucoup d’argent, passant son temps avec des bandes de beatniks, de hippies, ce genre de choses. Je me souviens d’un été à Cassis : ils faisaient la manche, après ils allaient se baigner nus dans les calanques, ils ricanaient beaucoup sur les « bourgeois »… C’était le tout début des années 70, j’avais 13 ou 14 ans. Elle est aussi partie à Katmandou, à Tanger, tout le merdier. Je n’avais que mépris pour ces individus oisifs et égoïstes. L’image du Bien, pour moi, c’était mes grands-parents, qui m’élevaient. Tout le contraire : des prolétaires vertueux, évidemment communistes, ayant travaillé toute leur vie… Au lycée, il y avait toute une panoplie de mouvements incompréhensibles : gauchistes, écologistes… Tous ces gens m’inspiraient la plus profonde répulsion. D’une manière générale, je n’étais pas très politisé. Il faut dire aussi que je ne réalisais pas du tout l’importance de l’argent à cette époque ; j’étais nourri logé, je n’avais pas de problème. Ce n’est qu’en travaillant, des années après, que je me suis rendu compte que j’étais très mal adapté au capitalisme.
« À 13 ans, j’essayais de formuler des idées sur la meilleure manière d’organiser le monde, parce que visiblement c’était très mal organisé »
Par la suite, tu t’es retrouvé en région parisienne ?
J’étais en résidence universitaire à Bures-sur-Yvette, j’allais au lycée dans le XIIe, je me levais tôt, je rentrais tard après la fermeture du restaurant universitaire, je travaillais beaucoup et ne connaissais personne. Je trouvais donc l’environnement assez pénible. Dans la foulée, j’ai fait l’École d’agronomie de Paris, essentiellement parce que je ne voyais pas très bien quoi faire et que j’avais lu dans la brochure Onisep qu’on trouvait des agronomes dans tous les secteurs professionnels. C’est à ce moment-là que se situe un épisode d’ailleurs étrange, parce que je ne connaissais rien au cinéma — je n’y étais pratiquement jamais allé. À l’Agro, j’avais un ami qui aimait bien les films fantastiques et m’avait emmené voir L’Ile du docteur Moreau. En rentrant, il a suggéré que le film n’était pas terrible, qu’on pourrait facilement faire mieux. Pendant le trajet du retour, on a mis sur pied un scénario ; il était acteur, j’ai fait réalisateur. On a trouvé d’autres comédiens, une caméra mécanique, une Bolex, et on a tourné un an et demi. J’ai fait un second film ensuite, une sombre histoire de petite fille qui posait des gages à un petit garçon, lequel revenait trente ans plus tard pour se venger alors que la petite fille devenue adulte était paralysée. Enfin, je n’ai pas énormément persévéré dans cette voie.
Tu continuais à écrire ?
Oui, au lycée, je m’étais mis à écrire mes rêves, surtout des cauchemars d’ailleurs. Lovecraft me fascinait. Mais, là aussi, je détruisais les textes au fur et à mesure. Et puis, vers l’âge de 20 ans, j’ai commencé à écrire en vers… Au départ, c’était presque un jeu de société. On improvisait, les choses allaient très vite, on avait quelques minutes pour écrire et les gens donnaient tout de suite leur avis. La versification m’a beaucoup aidé, je me laissais guider, je ne savais jamais ce que j’allais écrire à l’avance, et le résultat était meilleur. Comme dans le blues, le rythme guidait ce qui était dit. Si paradoxal que cela paraisse, j’utilisais l’alexandrin comme méthode d’écriture automatique. C’est là aussi que j’ai constaté que j’intéressais des gens ; pour moi, c’était inédit. J’ai commencé à garder mes textes.
Tu avais l’intention de publier ?
Je n’y pensais pas. L’idée que l’écriture pourrait constituer une activité au sens fort du terme m’est venue progressivement, en corollaire de l’échec de plus en plus patent de ma vie professionnelle. J’ai commencé par être refusé à tous les postes d’agronome auxquels je postulais. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que je faisais mauvaise impression pendant l’entretien. Mais j’ai vraiment beaucoup cherché, j’ai répondu à plus de cent offres, j’avais les diplômes qu’il fallait, tout… Forcément, à l’occasion de cette recherche d’emploi, j’ai commencé à ressentir un certain agacement à l’égard de la société dans son ensemble. Si bien que lorsque j’ai finalement trouvé un boulot, dans l’informatique — et encore, uniquement par piston —, je partais sur de mauvaises bases, j’étais déjà mal disposé.
Tu as donc commencé par le chômage et tu es resté chômeur longtemps.
Un an et demi. En plus, j’étais marié… Mon épouse avait raté son bac trois fois. Elle n’avait trouvé qu’un emploi de femme de ménage à mi-temps. Dans ce contexte difficile, j’ai cependant décidé de me reproduire… Comme un acte de foi… Si bien que pendant un certain temps j’ai été père au foyer. Quand j’ai finalement trouvé du travail, je me suis tout de suite fait horriblement chier, et ça se voyait. Je n’aimais pas ce que je faisais, je n’aimais pas les gens qui m’entouraient. Dans le meilleur des cas, je restais un an dans une boîte. Mais on trouvait facilement dans l’informatique à ce moment-là. Maintenant, ce ne serait sans doute plus possible. En général, j’allais dans une boîte de services, on m’envoyait chez un client, je convenais mal et me faisais virer au bout d’un temps plus ou moins bref. De plus, les anciens amis que j’avais gardés du temps de mes études devenaient de plus en plus amers. On menait tous des vies assez chiantes chacun de son côté et, quand on se revoyait, on ne pouvait que constater l’échec commun ; d’où une ambiance de plus en plus morne dans les soirées. Je me suis rapidement rendu compte que les gens mentaient autour de moi. Tout le monde faisait semblant d’aller bien, de participer. Tout ça n’était qu’un jeu de rôles. Ce n’était pas du tout la belle vie. J’ai commencé à faire une série de dépressions… Enfin, si on peut appeler ça comme ça. J’étais systématiquement diagnostiqué comme dépressif, mais dès les premières semaines d’arrêt maladie j’allais nettement mieux. L’explication sociologique a donc tout de suite pris un certain poids. En même temps, je continuais à écrire. J’ai beaucoup écrit pendant mes déplacements professionnels, notamment mes premiers textes en prose, dont certains passages d’Extension du domaine de la lutte. Difficile de dire pourquoi j’écrivais ça. Je sentais que quelque chose n’allait pas, qu’il était important de le mettre noir sur blanc, mais je ne voyais pas pourquoi c’était important.
« J’ai très peu vu mes parents pendant mon enfance. En un sens, c’était des précurseurs du vaste mouvement de dissolution familiale qui allait suivre »
Tu n’as pas du tout vécu les années 70 comme une libération. Tu aurais donc dû voir arriver les années 80 avec enthousiasme.
Non. Pour moi, il n’y avait pas de rupture. Ça faisait vingt ans qu’on voyait l’économie de marché investir le champ libidinal sous couvert de libération des mœurs, les années 80 me semblaient une suite logique de la glorification des égoïsmes.
Il y a dans tes textes une nostalgie presque militante de l’élan révolutionnaire.
Oui. Je ne vois toujours pas de raison pour que des gens soient plus payés que d’autres. Je suis toujours partisan de la collectivisation des moyens de production ; je trouve normal que tout le monde soit fonctionnaire. Cela étant, il est clair que j’ai une certaine difficulté à faire coïncider toutes mes opinions parce que, bien que partisan d’une société communiste, je pense que ça ne marcherait pas très bien avec des individus comme moi… Tout en étant hostile à l’individualisme, j’ai été fortement marqué par mon époque, aussi. Je suis aussi individualiste et indifférent aux autres que n’importe qui. Par ailleurs, j’ai peur des mouvements collectifs. Je pense qu’une bande ou une foule est toujours abjecte.
On trouve aussi dans certains de tes poèmes des allusions à la religion, Bouddha ou Jésus.
Il y a une désagrégation du lien social et familial, une perte du sens, une fin de civilisation. Je ne suis pas pessimiste — des civilisations, il y en aura d’autres. Mais cela crée une atmosphère assez triste. Parce que rien n’a été résolu dans le domaine de la mort. Si bien que les humains constituent un regroupement un peu hasardeux, n’ayant pour conception claire et dominante que leur moi, promis à la mort. En plus, on vit quand même dans un pays qui s’appauvrit. Donc les gens sont tristes, et leur tristesse croît au fur et à mesure que leur âge augmente. En même temps, individuellement, ils deviennent moins intéressants. Cela étant, j’aimerais bien trouver quelque chose de positif à dire. Donc je cherche quelque chose qui fasse sens pour le collectif, et dans cette quête, il m’arrive d’avoir des élans mystiques, disons pendant un quart d’heure — mais un quart d’heure, ça peut suffire pour écrire un poème. Je dois malheureusement reconnaître qu’après avoir écrit ça je ne me sens pas plus avancé pour autant, toujours aussi peu religieux.
« Il est clair que j’ai une certaine difficulté à faire coïncider toutes mes opinions parce que, bien que partisan d’une société communiste, je pense que ça ne marcherait pas très bien avec des individus comme moi »
L’une des valeurs qui se dégagent de certains poèmes, c’est la résistance, l’idée de résistance.
Oui, c’est quelque chose qui m’émeut beaucoup. Un petit groupe de gens luttant clandestinement pour un idéal… Je suppose que, quand on est pourchassé par tout le monde, on est ensemble, vraiment. C’est ça qui est émouvant. Ce pour quoi on résiste est presque un détail par rapport à la beauté de la situation.
Ça pourrait être aussi bien une définition du terrorisme.
Je dois le reconnaître, oui, bien que je le désapprouve dans le principe.
Tu as commencé par écrire des poèmes, puis tu es passé au roman, à présent tu reviens avec un nouveau recueil de textes poétiques. Pourquoi privilégier l’écriture poétique ?
Il y a une première raison, c’est qu’un poème peut s’écrire très vite. Lorsque je travaillais dans la journée, je disposais de temps de liberté mentale relativement brefs. Une autre raison, c’est que les choses me viennent plus sous forme de fragments. Pour moi, il y a dans ce recueil de poèmes plusieurs romans potentiels. La découverte qui a vraiment changé ma vie, c’est que lorsque j’arrivais à me mettre dans des états propres à écrire de la poésie, quand je me laissais envahir par le rythme, j’arrivais à trouver des choses dont je ne soupçonnais pas l’existence en moi. Et ces choses se présentent d’abord sous forme de poèmes. Ensuite, il est certain qu’il y a des intuitions, des manières d’envisager le monde qui peuvent être explicitées dans un roman.
Tes textes sont un mélange unique de prosaïsme et de classicisme. Quelles sont tes influences ?
J’ai parfois le sentiment que Baudelaire a été le premier à voir le monde posé devant lui. En tout cas, le premier dans la poésie. En même temps, il a considérablement accru l’étendue du champ poétique. Pour lui, la poésie devait avoir les pieds sur terre, parler des choses quotidiennes, tout en ayant des aspirations illimitées vers l’idéal. Cette tension entre deux extrêmes fait de lui, à mon sens, le poète le plus important. Ça a vraiment apporté de nouvelles exigences, le fait d’être à la fois terrestre et céleste et de ne lâcher sur aucun des deux points. Pour le reste, et pour rester dans le domaine poétique, Apollinaire. Je connais mal la poésie du XXe siècle, je connais mieux la musique. Leonard Cohen, évidemment.
Tu sembles complètement à l’écart des courants avant-gardistes, que ce soit sur le plan poétique ou romanesque. Pour toi, écrire, c’est avoir une vision du monde.
D’une part, je suis nettement conscient de l’histoire. C’est-à-dire que des conditions du monde nouvelles existent, qui n’ont jamais existé jusqu’à présent. Et c’est en fait la seule véritable justification pour continuer à écrire des livres. La Bruyère, que j’aime beaucoup, était tout à fait sincère en écrivant « On vient trop tard, tout a été dit depuis sept mille ans qu’il y a des hommes, et qui pensent ». C’est-à-dire que lui avait le sentiment de vivre dans un monde clos — en gros, parce que, surtout lorsqu’il observe les paysans, il a une vague conscience que tout ça va craquer, et c’est probablement ce qui l’a tout de même conduit à écrire. Il avait des doutes. Moi, j’ai plus que des doutes. Par ailleurs, il n’y a pas d’histoire littéraire isolée. C’est particulièrement évident depuis l’apparition du livre de poche. Pendant mon adolescence, j’ai lu vraiment beaucoup de choses, mais je ne prêtais pas attention à l’époque de l’auteur, à son pays d’origine, à sa vie… Donc, sur le plan littéraire, je ne me sens pas le fils de la génération qui m’a précédé, ni plus ni moins que celui de Cervantès ou de Dostoïevski. Je suis quelqu’un qui relit énormément, si bien que peu d’auteurs m’ont vraiment influencé — j’ai tellement relu que j’ai finalement assez peu lu.
Tu as dit que l’un des dangers qui guettent le roman, c’est le caractère des personnages.
Mais le danger principal me semble être le style. Ça, même les meilleurs romanciers y échappent difficilement. Ils se trouvent un style, se constituent une petite niche stylistique avec des procédés qui n’appartiennent qu’à eux et refont la même chose jusqu’au bout. Ça produit parfois des œuvres très impressionnantes, d’ailleurs. Céline, c’est pas mal, mais je trouve que Le Voyage est ce qu’il a fait de mieux — après, ça tourne au procédé. Ce qui est remarquable chez Nietzsche, c’est qu’il change à chaque fois de style. Il n’a pas fait de roman, mais il a tout de même une palette stylistique extrêmement variée. Je ne sais pas si j’ai raison, il est possible que l’unité de style produise des œuvres plus accomplies, mais j’ai toujours admiré ceux qui sont capables de changer. C’est aussi une réponse à la question du passage de la poésie au roman.